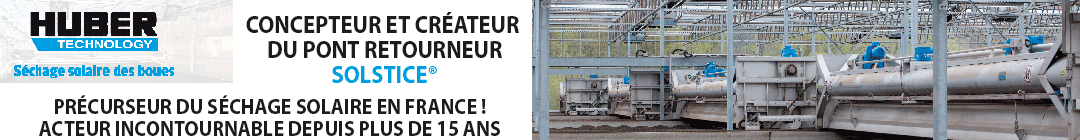L'accroissement des contraintes concernant la gestion des effluents, l'évolution des normes de rejet et les restrictions d’eau en période de sécheresse obligent les industriels à aller vers des procédés de traitement de l'eau toujours plus performants. Version optimisée du traitement biologique conventionnel, les bioréacteurs à membrane (BRM) s'imposent désormais comme des solutions innovantes pour le traitement des eaux usées. Cet article explore les évolutions réglementaires et les avancées techniques qui positionnent les BRM au cœur des stratégies de développement durable.
Les bioréacteurs à membrane (BRM) sont des réacteurs biologiques à boues activées, qui combinent un processus de dégradation biologique, connu sous le nom de « boues activées », à une séparation solide-liquide par filtration membranaire. On distingue deux grandes familles de BRM aérobies : les BRM directement immergés en bassin biologique et les BRM à recirculation externe, aussi appelés réacteurs tubulaires. Les BRM aérobies immergés, probablement les plus courants, existent également en deux sous-familles. Il y a d'un côté les BRM à plaque, comme ceux proposés par Alting et Mann+Hummel, et de l'autre les BRM à fibres creuses commercialisés par Veolia, Toray et DuPont.
LES BRM : DES TECHNOLOGIES EFFICACES MAIS COMPLEXES.

Ces deux familles de BRM ont toutes les deux leurs avantages et inconvénients. Les bioréacteurs à plaque semblent ainsi plus robustes car ils ne nécessitent pas de maintenance, alors que les modèles à fibres ont tendance à s'endommager facilement. Les plaques ont aussi une meilleure tolérance aux eaux très chargées et sont plus faciles à nettoyer. En revanche, les BRM à fibres présentent une compacité plus grande et leur prix au mètre cube est, en général, moins élevé.
Concernant les réacteurs tubulaires, ces derniers sont plus faciles d’entretien, car physiquement accessibles, mais aussi plus consommateurs d’énergie. Maxime Pollet, responsable du développement commercial chez Ovive, intégrateur de BRM reconnu dans l’industrie, conseille ainsi de privilégier les membranes tubulaires externes « pour de petits débits, en dessous de 20 m³/h ». Il précise néanmoins que cela dépend vraiment des situations car « il y a d'autres paramètres à considérer, notamment le fait que l'effluent soit encrassant ou non, à cause de la présence de graisses ou de matière abrasive. »
DES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES QUI FAVORISENT LA REUT
L'entretien des BRM est ainsi un paramètre important car le nettoyage des membranes est une opération très coûteuse qui rend indispensable la mise en place d'une filtration en amont. Plus il y aura d'éléments retenus par les tamis de filtration, plus la membrane restera propre et conservera une efficacité constante. Passavant Geiger propose deux types de tamis bien adaptés à la protection des membranes : le tamis rotatif incliné Noggerath RSI-DD et le dégrilleur à bande Centre-Flo. Pour ce dernier, « le taux de capture des refus est le plus élevé du marché (jusqu'à 85 %) », affirme la société.
Les évolutions réglementaires récentes vont clairement dans le sens d'une densification du parc de filtration membranaire, qui apparaît comme une réponse technologique stratégique. La réutilisation des eaux usées traitées a ainsi été introduite dans le Code de l'environnement par le décret n° 2023-835 du 29 août 2023. Ce texte fixe les conditions d'utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie pour l'ensemble des usages non domestiques et décrit la procédure d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées. Si ce texte a été complété par l'arrêté du 28 juillet 2022, qui précise la composition du dossier de demande d'autorisation, il est prévu que d'autres arrêtés « thématiques » soient publiés afin de préciser les conditions d'utilisation des eaux usées traitées par type d'usage. Dans ce contexte, deux arrêtés relatifs aux conditions de production et d'utilisation d'eaux issues du traitement des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures (en lien avec le règlement européen du 25 mai 2020 sur ce même sujet) ou d'espaces verts ont d'ailleurs déjà été publiés en décembre 2023 : l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts, et l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation des cultures. Un autre arrêté thématique est aussi en cours de préparation : celui-ci définira les prescriptions applicables à l'utilisation d'eaux usées traitées pour les usages liés à la propreté urbaine (nettoyage de voirie, hydrocurage des réseaux d'assainissement).
D'autre part, la nouvelle directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU 2), entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2025, va imposer un traitement renforcé de l'azote, du phosphore et des micropolluants. Concrètement, la mise en œuvre de cette directive va se traduire par la production d'eaux usées traitées de très bonne qualité, qui seront favorables à une réutilisation. Enfin, le cadre réglementaire français sur la réutilisation des eaux est désormais doté de textes spécifiques aux industries agroalimentaires (décrets n° 2024-33 du 24 janvier 2024 et n° 2024-769 du 8 juillet 2024) et sur l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine (décret n° 2024-796 et arrêté du 12 juillet 2024, décret n° 2025-239 du 14 mars 2025).
DÉJÀ DES INVESTISSEMENTS MAJEURS DANS LES STEP
Selon Vincent Rocher, directeur délégué Innovation, Stratégie et Environnement du SIAAP, sur les six usines que compte le syndicat, deux sont déjà équipées de BRM immergés, dans le but de restituer, dans la Seine, une eau de qualité supérieure.

« L'usine Seine Aval, située dans les Yvelines en aval de Paris et considérée comme la plus grande station d’épuration d'Europe, dispose, depuis 2017, de 28 cuves membranaires de 300 m², chacune représentant une surface filtrante de 462 000 m² pour le traitement d'une partie des eaux usées de l'usine. L'usine dispose également d'une unité de traitement membranaire des jus issus de la déshydratation des boues digérées dotée de six cuves membranaires offrant une surface totale de filtration de 15 560 m², qui renvoie une eau filtrée en tête de station », explique Vincent Rocher.
La seconde usine, Seine Morée, située en Seine-Saint-Denis, a été mise en route en 2014. « C'est la plus récente et aussi la plus compacte du SIAAP. Elle a récemment vu sa capacité de traitement augmenter de 30 000 à 45 000 m³/j et elle est équipée de huit cuves membranaires, de 300 m² chacune, représentant une surface filtrante de 106 000 m² », poursuit-il. Pour Pascale Sajus, directrice des études stratégiques et prospectives au SIAAP, « le retour d'expérience montre que le renouvellement décennal des membranes doit être anticipé, tant pour des raisons techniques qu’économiques ».
Le SIAAP prône ainsi une gestion patrimoniale maîtrisée de ses installations et les équipements membranaires n’échappent pas à la règle. L'analyse des indicateurs de fonctionnement, notamment la perméabilité et la pression transmembranaire (PTM), permet aujourd'hui d’anticiper le moment opportun pour engager le renouvellement de la surface filtrante sur l'usine Seine Aval. Pascale Sajus précise par ailleurs que « les évolutions technologiques récentes permettent désormais d’installer des modules offrant une surface de filtration accrue d'environ 20 % et sans modification du génie civil ».

D’autres projets, notamment de réutilisation des eaux usées traitées (REUT), portés par Suez, intègrent également des BRM. C'est le cas de la station du Cap d'Agde (Hérault), qui permet d’arroser les pelouses du golf situé à proximité, depuis 2020, ou encore la station d’épuration Carré de Réunion, qui irrigue depuis 2022 la ferme de Gally, dans les Yvelines. D'après Denis Snidaro, directeur technique adjoint de l’activité Eau en France chez Suez, « l'entreprise exploite 42 stations d’épuration équipées de bioréacteurs à membrane, pour une capacité nominale cumulée de 1,9 million d’équivalents-habitants (EH) ».
En traitement des eaux usées, les bioréacteurs à membrane offrent en effet de nombreux avantages par rapport aux systèmes de traitement conventionnels. En particulier, la combinaison entre un BRM et un réacteur à boues activées permet d’obtenir une plus grande efficacité d’élimination des matières organiques. Avec un BRM, il est non seulement possible d’obtenir une eau de très haute qualité en sortie, mais aussi une qualité constante, tout cela dans une installation compacte et modulaire.
Oscar Mallola, Export Manager chez Sigmadaf, met ainsi en avant les avantages pour les collectivités en termes de process. Selon lui, les BRM comme ceux de Sigmadaf permettent une « gestion du processus simple et économique car il n'y a pas de sédimentation dans le réservoir biologique. L'opérateur doit simplement contrôler le fonctionnement de la pompe de perméat et de recirculation ainsi que les pressions de travail. Les paramètres de travail sont contrôlés par un PLC [automate programmable industriel, NDR] avec la possibilité de connexions à distance par modem ».
LES BRM PASSENT LES PORTES DE L'INDUSTRIE
Les BRM peuvent aussi être utilisés pour de nombreuses applications industrielles. Julien Jammet, responsable commercial chez Actibio, donne l'exemple de la société Chemviron, un fabricant de charbons actifs, qui a opté pour le traitement de ses effluents via un de ses BRM, afin de traiter 1000 m³/j d'effluents, une partie étant recyclée et l’autre rejetée. De son côté, la société Ovive estime à 150 le nombre d’installations industrielles qu'elle a réalisées jusqu'à présent. Si les principaux secteurs sont le pharmaceutique,

L'agroalimentaire et la cartonnerie, Maxime Pollet rappelle que le BRM a aussi sa place dans des process industriels particuliers, « notamment en fonderie automobile, pour l'élimination du glycol utilisé en démoulage ».
En outre, l'utilisation des BRM va bien au-delà de l'industrie, puisque, selon Oscar Mallola (Sigmadaf) déploie des installations « aussi bien dans l'industrie que pour des applications spécifiques, comme les camps militaires, les missions humanitaires, les hôtels et les centres de villégiature, ou encore des hôpitaux et des centres commerciaux ».
Cette polyvalence du BRM est liée à la possibilité d’adapter le procédé à chaque type d'effluent traité. Nicolas Martin, directeur commercial d’Apro Industrie, précise que, « dans une station d’épuration industrielle, les produits à traiter peuvent être de nature très différente, ce qui oriente le choix de souches de bactéries adaptées à la dégradation de ces polluants ». Enfin, il rappelle que les bassins utilisés en traitement biologique doivent être capables de résister aux environnements agressifs rencontrés en milieu industriel. « La présence de matières en suspension pouvant être abrasives, la variabilité physico-chimique des effluents et le fort brassage lié à l'aération nécessitent l'utilisation de matériaux comme l'acier inoxydable, l'acier vitrifié ou l'acier revêtu époxy », explique Nicolas Martin.
Le déclenchement d'un arrêté sécheresse par la préfecture peut obliger les gros consommateurs industriels à baisser drastiquement leurs prélèvements d'eau dans les 48 h. Dans les zones régulièrement impactées par la sécheresse, la réutilisation de l'eau apparaît donc comme une nécessité et le BRM comme un allié stratégique, l'industrie n’étant pas prioritaire en cas de conflit d'usage sur l'eau. Mais qu’en est-il du coût de traitement ? Maxime Pollet (Ovive) rappelle que, « dans l’industrie, le coût d'une unité de Reuse [réutilisation d’eaux usées traitées ou REUT, NDR] associée à un BRM est faible, si on le compare à celui de la perte de plusieurs journées de production. Or le BRM est actuellement l’outil de traitement biologique le plus abouti en termes de performance et le plus adapté à l’ajout d'un Reuse ». Il précise en outre que les projets de REUT sont plutôt bien subventionnés.

Par ailleurs, lorsqu’ils sont couplés à d'autres technologies, comme l’évapoconcentration, les BRM permettent des mises en zéro rejet liquide, et cela même si les flux contiennent des éléments volatils. Julien Jammet (Actibio) estime même que, « grâce à ce premier traitement qui élimine les sels et les perturbateurs biologiques, il n'y a plus de limites au traitement biologique. » Néanmoins, si les BRM permettent d’améliorer considérablement la qualité des traitements et de permettre les économies d'eau, d’après Damien Kuntz, directeur technique et offres chez Suez E&C PC France, « le BRM est en moyenne 1,5 fois plus consommateur d’énergie qu'une station classique ».
Les technologies évoluent cependant et les professionnels comme Suez s'appuient sur le retour d’expérience des usines déjà en exploitation, en vue d'améliorer l’efficacité de leurs procédés de BRM. Suez propose ainsi aux exploitants un accompagnement par le Cirsee, son centre de recherche et d’expertise, afin d’évaluer la durée de vie résiduelle des membranes et la stratégie de renouvellement à adopter. Damien Kuntz rappelle par ailleurs que l'amélioration du procédé passe par une « bonne évaluation des débits à traiter et de la durée des pointes, mais aussi par une fiabilisation du tamisage fin de protection des membranes et diverses optimisations en termes de transfert d’oxygène, de consommation énergétique et sur les stratégies de lavage et de régénération chimique. »
Huber Technology, lui, propose une technologie de tamisage «unique» avec ses tôles perforées en forme d’étoile STAR, permettant un taux de capture élevé avec un débit hydraulique maximisé. Ces équipements sont prévus pour un fonctionnement fiable et durable, et font notamment leurs preuves sur l'usine d’Achères du SIAAP depuis 2015 avec 12 tamis à tôles perforées RPPS en étoile STAR 1 mm sur un débit de 4 m³/s en protection de traitement membranaire.

La compacité étant l'un des principaux atouts des BRM, des distributeurs proposent désormais la mise en conteneur de modules de BRM. C'est le cas d'Alting, dont la gamme de modules BioCel Mann+Hummel a été redessinée en 2022 afin de pouvoir rentrer dans un conteneur, en vue de répondre à la demande en installations mobiles. Selon Simon Poirier, ingénieur commercial filtration chez Alting, « l’unité mobile permet de compléter un traitement existant ou d'augmenter sa capacité de traitement, de manière compacte, en la juxtaposant à la station de traitement des eaux usées déjà existante. Ce besoin est boosté par les demandes de REUT, le BRM permettant d'améliorer les capacités de filtration ».
De son côté, Sigmadaf propose aussi la mise en conteneur ISO de BRM, ce qui facilite autant le transport que l'assemblage et, si nécessaire, l'extension du BRM, par exemple pour une utilisation dans des zones isolées, où la REUT de l'eau est nécessaire. L'effluent traité devient alors utilisable en irrigation agricole et peut servir à alimenter les chasses d'eau des toilettes. Par ailleurs, Oscar Mallola voit aussi d'autres avantages car « la mise en conteneur offre un traitement automatisé, évite les odeurs, n'attire pas les porteurs tels que les insectes et permet la désinfection sans UV ni produits chimiques ».
UN DOMAINE EN PERPÉTUELLE INNOVATION
Ces dernières années, de nouveaux projets de recherche et d'innovation concernant les BRM ont vu le jour. On peut citer le projet ANR BaMAn qui concerne le traitement des eaux à énergie positive et qui associe un bioréacteur anaérobie à membrane granulaire (G-AnMBR) à une membrane de dégazage, afin de produire du biogaz tout en réduisant l'encrassement membranaire.
Citons également le programme de recherche MOCOPEE qui vient de fêter ses 10 ans et qui étudie, entre autres, le vieillissement des membranes utilisées pour le traitement des eaux usées. Ce programme, initié et coordonné par le SIAAP, dispose notamment d’un axe de recherche consacré à la préservation des ouvrages de traitement.
Selon Sabrina Guérin, directrice Innovation du SIAAP, « plusieurs actions de recherche se sont succédé sur la question du traitement membranaire, en particulier la durée de vie de cet équipement et les conditions favorisant son vieillissement. Un appel à projets de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a permis de mettre en place une zone innEAUvation, c'est-à-dire un sas de test en conditions industrielles au cœur de Seine Aval. Un pilote a été installé en 2022 afin de tester une méthode de vieillissement accéléré des membranes et de réaliser des essais comparatifs entre différents types de membranes. Il a participé à l'évaluation, au plus juste, de la date de renouvellement des équipements membranaires de l'usine ».
Un second projet du SIAAP, financé par l’ANR, se clôture en cette année 2025. Il s'agit de REMemBer dont l'objectif est de développer de nouvelles membranes électro-réactives, capables de réaliser des traitements par électro-oxydation grâce à leur charge électrique. Sabrina Guérin précise qu’« il s'agit de coupler ces membranes à un procédé BRM afin de combiner les bénéfices de ces deux technologies. Cette approche permet de concevoir un système compact, performant et efficace pour la dégradation des micropolluants ». Deux essais sont par ailleurs en cours pour évaluer l'efficacité de ces membranes : un test en filtration continue de boue activée, afin d’évaluer les performances de filtration, et un second test en filtration de perméat, pour vérifier l'efficacité du procédé d'oxydation avancée. Ce projet met en collaboration le SIAAP, l'Inrae, la société Firmus et l'Institut européen des membranes (IEM).
Outre ces exemples, les sujets de recherche et d'innovation potentiels ne manquent pas, en ce qui concerne les BRM. Damien Kuntz (Suez) en répertorie plusieurs : « L'optimisation énergétique des procédés de traitement des membranes, du transfert oxygène, l'asservissement de l'usine et le pilotage par intelligence artificielle (IA), mais aussi le choix des membranes, le traitement intégré des micropolluants ou encore la réduction des émissions de N₂O. »