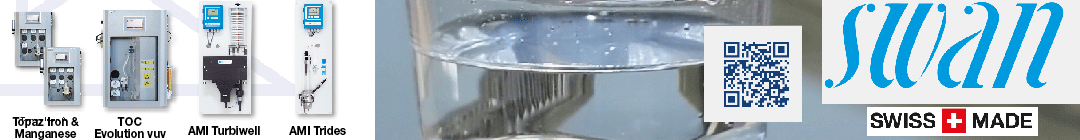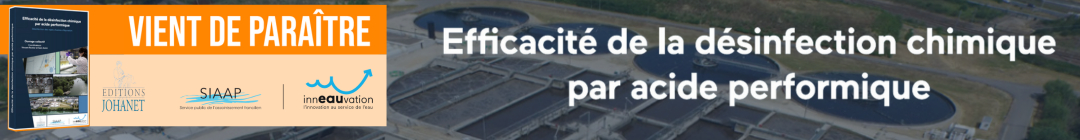Que ce soit dans certains process ou pour les utilités comme les TAR ou les chaudières, la désinfection de l’eau industrielle est aujourd’hui «?bousculée?» par la généralisation du recyclage et la montée des préoccupations environnementales. Les acteurs de ce marché ont en général anticipé ces évolutions et proposent des solutions adaptées à tous les cas.
Les industriels de l’agroalimentaire (entre autres) se doivent de désinfecter l’eau qu’ils utilisent dans leur process. Cela vaut évidemment encore plus pour l’eau ingrédient. Par ailleurs, toutes branches industrielles confondues, les utilités comme les tours aéroréfrigérantes (TAR) ou les chaudières vapeur exigent une eau à la fois désinfectée, déminéralisée, non corrosive, etc. D’où, pour ce type d’applications, le couplage fréquent des produits désinfectants avec des ingrédients anticorrosion, antitartre et/ou dispersants en des formulations complexes, propres à chaque type d’usage.
La désinfection de l’eau industrielle est depuis longtemps un marché bien établi où opèrent à la fois des généralistes comme Aquaprox, BWT, Veolia avec sa marque Hydrex® (Veolia), des fabricants de matériels d’analyses comme Cifec ou ProMinent et des acteurs plus spécialisés comme Eurochlore ou Gazechim (chlore gazeux), Ozonia (ozone) ou Kemira (acide performique), ainsi que les spécialistes de l’UV (BIO-UV Group, UVGermi, MPC UV Technology, Uvoji, Uvrer…), tous proposant des solutions éprouvées. D’où un paysage relativement stable…

jusqu’à ce que la généralisation de la réutilisation/recyclage, depuis quelques années, ne vienne rebattre les cartes. «Du fait du changement climatique et des sécheresses, les autorités limitent les autorisations de prélèvement, donc les industriels doivent recycler leur eau. Or recycler signifie désinfecter et traiter, donc éventuellement dénaturer l’eau avec des sous-produits de toutes sortes qui se concentrent avec les cycles de réutilisation» explique Jérémie Machémy, directeur commercial Europe et Afrique chez Evoqua Water Technologies, la branche de Xylem spécialisée dans le traitement de l’eau. «Avec l’évolution de la réglementation en matière de réutilisation dans l’agroalimentaire, par exemple les ECML1 , nous entrons dans une nouvelle ère. Il en va de même pour les eaux d’utilités excédentaires. L’inévitable concentration des sous-produits de désinfection dans les rejets va nécessiter des technologies, des chimies un peu différentes pour réduire l’impact des rejets au milieu naturel» renchérit Ludovic Lemieux, responsable technique des produits formulés chez BWT.
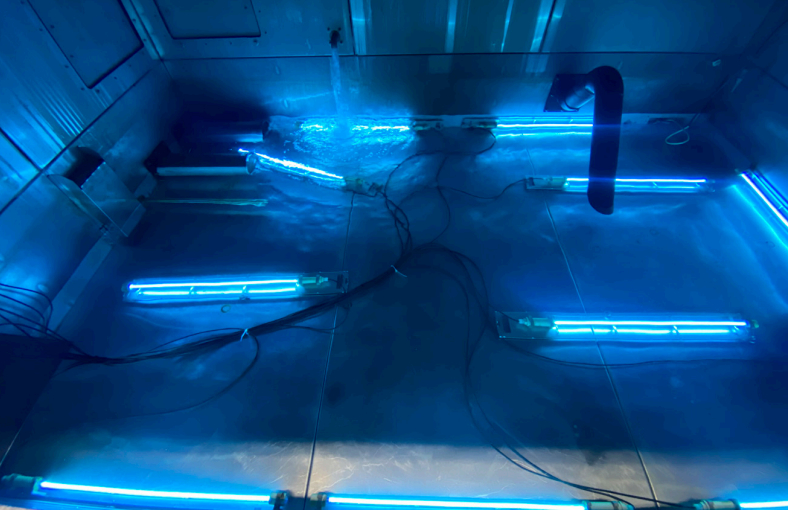
«Depuis 15 ans, nous équipons les utilités (+ de 70 bassins de TAR) sans aucune alerte Legionella Pneumophila 1 Eau de concentration de la matière laitière, longtemps appelée improprement «eau de vache» grâce à la parfaite maîtrise du couple UV + Pérox», avance Stéphane Menard, DG de MPC UV Technology. « Notre expertise combinée au monitoring des ajouts et au suivi de nos clients nous ont permis de passer sur des ajouts «en choc» du Pérox (non continu). Face aux restrictions de plus en plus drastiques, un grand groupe de l’industrie de la chimie a choisi la technologie UV + Pérox pour pouvoir rejeter ses eaux de purges en milieu naturel et ainsi gagner du «crédit eau» vis-à-vis de la DREAL pour les autres utilités», explique t-il. «Plus économique en plus d’être écologique, une autre grande société française du tertiaire a maintenu la solution MPC UV + Pérox pour ses datacenters après être passé sur Puits car notre technologie lui permet de redémarrer ses TAR immédiatement si besoin».
Autre trait commun, les fournisseurs de produits ou solutions désinfectants accompagnent en général leur offre de tout ce qui est nécessaire à l’utilisation: systèmes d’injection, de dosage, de contrôle, de surveillance à distance, etc. Certains vont même jusqu’à offrir des services d’assistance plus ou moins complets. Après tout, la désinfection n’est pas le cœur de métier de leurs clients industriels. «Nous proposons un package regroupant la chimie, les équipements (les systèmes d’injection, de régulation, de mesures en ligne), les services associés (assistance technique, expertise, formation), et de plus en plus le smart monitoring via Hubgrade, la plateforme digitale de Veolia. Nous l’avons en tout cas déjà décliné pour les TAR» explique par exemple Johann Scuiller, responsable de l’activité Hydrex® France, la marque de produits chimiques de Veolia.
Enfin, malgré une tendance compréhensible à prêcher pour sa paroisse, la
plupart des acteurs s’accordent rapidement sur le fait qu’il n’existe pas de
recette unique: il faut adapter la réponse
à chaque situation. «Si vous devez limiter les sous-produits de désinfection, les
UV sont intéressants. Ils ne sont cependant pas rémanents, donc si du biofilm
peut s’installer dans les conduites, vous
n’échapperez pas à l’utilisation d’un oxydant puissant. Il n’y a alors guère le
choix: chlore, ozone, dioxyde de chlore,
acide peracétique ou peroxyde d’hydrogène. Le chlore génère en général plus
de sous-produits que les deux autres»
énumère par exemple Jérémie Machemy
(Evoqua).
LE CHLORE DANS TOUS SES ÉTATS
Connu et utilisé depuis plus d’un siècle, le chlore reste le désinfectant majeur. Il est aujourd’hui proposé sous des formes diverses hypochlorite de sodium, dioxyde de chlore, chlore gazeux, électrolyse de sel qui présentent toutes, à des degrés divers, l’inconvénient d’être accompagnées de sous-produits, soit de fabrication soit d’interaction avec matière organique. Une question à prendre en compte mais qui peut se contrôler. «Du fait de son activité en eau potable, Veolia a fait beaucoup de travaux de recherche sur les sous-produits du chlore mais nous continuons à travailler avec des technologies basées sur cet élément pour les eaux industrielles pour des raisons de coûts, d’efficacité et de rémanence.

Sur les TAR, nous arrivons
à respecter les normes de rejet imposées
par la réglementation 2921 (AOX, THM,
chlorures, sous-produits de chloration)»
affirme ainsi Johann Scuiller (Hydrex®).
Encore dominant sur le marché, peu
coûteux et efficace, l’hypochlorite de
sodium plus connu sous le nom d’eau de
Javel, qui est en fait une solution aqueuse
d’hypochlorite de sodium et de sel de
cuisine (NaCl) commence toutefois à être concurrencé par d’autres formes de
chlore. En cause: sa demi-vie relativement limitée (30 à 40 jours en bonnes
conditions de stockage) et le fait que sa
production elle-même génère inévitablement des chlorates, sous-produits
indésirables.
Le dioxyde (ou bioxyde) de chlore s’accompagne pour sa part de chlorites,
donc son acceptabilité dépend des
normes locales. «En revanche, il attaque
les biofilms, ce que ne fait pas l’hypochlorite. Il est par exemple intéressant pour
tout ce qui est eau chaude sanitaire dans
les maisons de retraite, les hôpitaux, bref
là où un public fragile ne doit surtout
pas être exposé à la légionnelle» explique
Jérémie Machémy (Evoqua).
L’électrolyse de sel (NaCl, en général sous forme de saumure) pour produire in situ de l’hypochlorite de sodium a le vent en poupe. Elle évite en effet le transport et le stockage de produits chimiques et diminue la dose de chlorates injectés dans les circuits. La production de l’hypochlorite en génère certes toujours autant mais, puisqu’il est «frais» et n’a pas le temps de se décomposer avant utilisation, on dose finalement moins de liquide désinfectant, et donc de chlorates. Inconvénient: il faut acheter l’électrolyseur, ce qui représente un investissement. BWT avec son Eco-MX, Prominent avec la ligne des Chlorinsitu, Aquaprox avec l’Eco2 Cell ou Hydrex avec son OSG, entre autres, sont présents sur ce marché. «Les électrolyseurs ont de nombreux avantages techniques, économiques et environnementaux.

Une quarantaine d’unités OSG fonctionnent actuellement avec des débits plus ou moins importants, essentiellement en TAR» affirme ainsi Johann Scuiller (Hydrex®). Particularité chez Hydrex® : ces machines ne sont pas vendues mais mises à disposition avec le service associé selon notre modèle financier WAAS (Water As A Service). «Cela évite l’investissement au client et nous permet de l’accompagner lors de l’exploitation des unités d’électrolyse, notre offre commerciale incluant l’assistance technique, la maintenance préventive et curative de l’OSG sur toute la durée de la mise à disposition» précise Johann Scuiller. Outre de nombreuses TAR, Hydrex® peut citer une référence chez un fabricant de papier sulfurisé, qui lave son papier après sulfurisation avec une eau brute désinfectée par électrolyse de sel. «Avec notre solution OSG Hydrex, nous traitons non seulement une boucle d’eau de 120 m3 /h mais nous avons aussi résolu le problème d’encrassement d’un échangeur à plaques causé par du biofilm et des bactéries sulfatoréductrices.
C’est une
alternative moins coûteuse et plus sécurisante pour le client que d’autres biocides oxydants conventionnels (chlore ou
brome, en solutions plus concentrées)»
détaille Johann Scuiller (Hydrex®).
Produit pur, le chlore gazeux ne contient
à l’origine pas de chlorate ou autres composés indésirables cela n’empêche toutefois pas la formation ultérieure de
chloramines, par exemple, par réaction
avec la matière organique contenue dans
l’eau à traiter. Mais surtout, le chlore
est un gaz toxique et délicat à manipuler, en particulier en zone urbaine, d’où
les réticences de certains clients potentiels. C’est le terrain de jeu de spécialistes comme Gazechim ou Eurochlore.
«Nous le commercialisons sous forme de
bouteilles de différentes capacités (de 6
à 50 kilos), systématiquement accompagnées des équipements d’utilisation:
chloromètre, débitmètre, hydroéjecteur,
analyseur, organes de sécurité, fermetures
automatiques, détecteurs et dispose d’une
équipe pour la mise en place et l’entretien
du matériel» explique Matthieu Rolland,
ingénieur commercial chez Eurochlore.

Afin d’assurer la sécurité, Eurochlore utilise exclusivement des chloromètres à dépression qui se coupent automatiquement en cas de fuite. C’est la solution qu’a choisie la société Ardo, spécialisée en préparation de légumes, d’herbes et de fruits surgelés, à Gourin, dans le Morbihan. «Ils recyclent l’eau de lavage, par exemple pour nettoyer des épinards. Pour la désinfecter, nous avons installé un système à deux bouteilles, avec bascule automatique (et alarme) de l’une à l’autre lorsque la première est vide, leur donnant une autonomie de deux mois. L’installation comprend également un capteur de chlore gazeux placé dans le local des bouteilles, qui déclenche leur fermeture automatique, via de petits moteurs placés sur les têtes de robinets, en cas de fuite» précise Matthieu Rolland.
Evoqua
a également installé ce type de solution,
par exemple auprès de laiteries ou de
fromageries. Là aussi en installant des
capteurs et des systèmes de fermeture
automatique des bouteilles…
ProMinent a développé un système
d’électrolyse du sel dénommé Dulcolyse
qui garantit un taux de chlorates inférieur à 10 ppb de chlorates lors d’un
dosage de 1 ppm de chlore, ce qui est
une valeur cible recherchée par l’industrie agroalimentaire et plus particulièrement par l’industrie de fabrication de
nourriture infantile.
Déployé dans plusieurs dizaines d’usines
agro-alimentaires, principalement
pour le lavage de produits crus prêt à
l’emploi, appelé quatrième gamme, le
chloromètre de sécurité CHLORO+ de Cifec permet de doser avec précision
des doses très faible de chlore gazeux
tout en nécessitant une maintenance
très réduite. Comme l’indique Luc
Derreumaux (Cifec), «l’intérêt du chlore
gazeux est sa stabilité et le fait qu’il forme
directement de l’acide hypochloreux au
point d’injection (chlore actif) beaucoup
plus bactéricide à même dose que l’ion
hypochlorite obtenu par la Javel ou l’électrochloration. Cela permet d’obtenir une
désinfection en conformité avec la réglementation européenne (UE) 2020/749 sur
les chlorates dans l’alimentaire».
LE PEROXYDE D’HYDROGÈNE, UNE ALTERNATIVE
Souvent choisi lorsque les sous-produits
du chlore représentent un problème
insurmontable, le peroxyde d’hydrogène (H2
O2
, aussi connu sous le nom
d’eau oxygénée qui est en fait sa solution aqueuse) est un oxydant puissant.
Il est en général produit sur place par
des générateurs, à l’instar de l’Eco-UV+
de BWT. «Lorsque le chlore et les autres
halogènes comme le brome sont inutilisables à cause des sous-produits, nous
proposons l’Eco UV+. Il combine UV
et peroxyde d’hydrogène en continu à
faible dosage, avec d’excellents résultats» affirme Ludovic Lemieux (BWT).
Entre autres référence: des gigafactories du Nord de la France, puisant leur
eau de refroidissement dans un canal.
«Ils doivent à la fois limiter leurs prélèvements d’eau et leurs rejets de sousproduits dans le canal. Ils font donc
tourner leur eau de TAR en boucle. Pour
la désinfection, la solution Eco-UV+ s’est
imposée» explique Ludovic Lemieux.
ProMinent propose pour ce produit qui
est de nature dégazant, des pompes
doseuses adaptées, qui garantissent un
dosage sans interruption et des sondes
de mesure de type ampérométrique qui
mesurent soit la présence ou l’absence
d’H2
O2
dans l’eau.
OZONE : UN MARCHÉ DE NICHE EN FRANCE
C’est l’autre grande alternative au chlore. Molécule de trioxygène (O3 ), l’ozone est un gaz désinfectant, super oxydant et de faible rémanence. En quelques minutes, il se décompose en effet spontanément en dioxygène (O2 ), autrement dit l’«oxygène» que nous respirons. Pour l’utiliser, il faut donc investir dans un générateur qui le fabrique in situ à partir du dioxygène de l’air. C’est le terrain de jeu de spécialistes comme Ozonia (Veolia) et ProMinent mais il peut aussi être combiné à d’autres solutions comme le fait BIO UV Group, qui, grâce au rachat de triogen® a intégré la maitrise de la technologie ozone à son portefeuille de produits UV. Les générateurs proposés visent le traitement des eaux de process, l’eau d’embouteillage ou encore l’aquaculture.
Dernier système lancé en 2022, PPO3 . Il intègre une matrice de rendement et de concentration d’ozone de pointe, pompe de suppression et des dispositifs de sécurité (via alarmes) et a été récemment installé chez un grand industriel de la boisson pour sécuriser son eau d’embouteillage. Certains généralistes proposent aussi une combinaison des deux. «En général, le générateur est utilisé pour obtenir des eaux de très grande qualité, à la fois totalement désinfectées et exemptes de sous-produits, par exemple pour le rinçage de bouteilles. Bien qu’encore peu connu pour cette application, il peut aussi être intéressant pour le NEP: on économise de l’eau en rinçant avec de l’eau ozonée, ce qui évite la phase de désinfection pure» explique ainsi Jérémie Machémy (Evoqua). Reste que le futur de l’ozone est en suspens car ce gaz est «dangereux» en lui même si des personnels viennent à en respirer. Il faut donc prendre soin d’éliminer l’ozone résiduel.

«Ce n’est pas un
problème pour les circuits fermés des process pharmaceutiques ou cosmétiques,
par exemple» explique Alain NGuyen,
ingénieur Technico-commercial chez
BIO-UV Group. En revanche, pour
les applications semi-ouvertes (TAR,
lavages) qui impliquent la possibilité
d’une diffusion dans l’air d’ozone ou de
sous-produits d’oxydation, la réglementation européenne serait en train
d’évoluer.
ProMinent propose ses générateurs
d’ozone pour des applications industrielles comme les rinceuses de bouteille ou pour les NEP. La gamme OZVb
fabrique de l’ozone à partir d’air comprimé pour être injecté directement
dans le circuit à traiter, tout en garantissant une non émanation de l’ozone
vers les opérateurs, grâce à une offre globale qui inclut l’étude, divers accessoires de sécurité, des sondes de mesure
d’ozone dans l’eau et dans l’air et un
contrat d’entretien.
QUAND UTILISER DES UV ?

Les rayons ultraviolets tuent tous les germes qui passent dans l’appareil sans créer le moindre sous-produit. En revanche, ils n’offrent aucune rémanence. Ils sont donc adaptés, par exemple, à de l’eau de process qui tourne en boucle et repasse régulièrement dans le réacteur. Evoqua a ainsi vendu des systèmes UV à un industriel qui récolte et rince des pommes. «Ils les nettoient avec une eau qui tourne en rond, ce qui économise beaucoup d’eau.
Elle est juste
désinfectée aux UV» explique Jérémy
Machémy.
BIO-UV Group a pour sa part installé des
réacteurs chez un industriel de l’agroalimentaire produisant des quenelles et des
ravioles, autant de produits qui doivent
être rapidement refroidis après cuisson et avant l’emballage. Cela se fait
en les plongeant dans une eau glacée,
laquelle tourne boucle et doit être désinfectée sans sous-produits qui pourraient
contaminer les aliments. «Depuis l’installation, ils n’ont jamais détecté de bactéries dans leur bain. A cause du contact
alimentaire, les UV étaient la seule solution… avec les membranes, beaucoup plus
coûteuse» affirme Alain Nguyen (BIO-UV
Group).
LES TAR (ET CHAUDIÈRES) : DES FORMULATIONS COMPLEXES
De l’eau chaude qui tourne en boucle, des dépôts quasi inévitables de tartre, voici des conditions idéales pour le développement bactérien dans l’eau et sous forme de biofilm sur les parois. En particulier de la redoutable légionnelle, qui a posé bien des problèmes dans les TAR et systèmes de chauffages collectif. Babcock Wanson Water, BWT, Aquaprox, Hydrex® ou Evoqua, entre autres, interviennent sur ce segment avec des formulations chimiques complexes. «Sur les TAR, nous avons historiquement beaucoup travaillé avec de l’hypochlorite de sodium, combiné ou non à du bromure de sodium, ou du brome stabilisé pour la désinfection, en complément de biodispersant pour lutter contre le biofilm. Toutefois, avec les réglementations qui tendent à réduire (voire prohiber) l’usage des biocides non oxydants, certains précurseurs de biocides, les produits de décomposition et les sous-produits de désinfection, nous poussons depuis bientôt 10 ans l’électrolyse de sel.
A court terme, certains clients se tourneront davantage vers cette solution qui est une alternative plus écologique aux biocides oxydants conventionnels» souligne Johann Scuiller (Hydrex®). Même perspective chez BWT: «nous n’allons plus pouvoir utiliser des traitements à base d’halogènes chlore ou brome dans les TAR à cause des sousproduits» affirme ainsi Ludovic Lemieux. BWT, comme ses concurrents, propose des formulations complexes pour lutter à la fois contre les germes pathogènes, la corrosion, le tartre et les biofilms. Une particularité: la firme recherche des produits biosourcés et biodégradables pour remplacer les classiques composés issus du pétrole. «Nous commercialisons déjà 3 premiers produits de notre gamme de chimie Verte, biodégradables, testés chez Fraicheur de Paris et dont les résultats sont concluants» poursuit le spécialiste.
Aquaprox fait de même avec sa ligne Eco2 Protect de produits issus du végétal, déclinée en Eco2 Protect C pour les TAR, Eco2 Protect B pour les chaudières et la petite dernière, Eco2 Protect S pour le process, en particulier les stérilisateurs et pasteurisateurs. Ces produits sont proposés avec des systèmes complets de dosage et de contrôle, dont des logiciels spécifiques à chaque application. Eco2 Protect C «a fait ses preuves pour les TAR depuis quelques années maintenant, avec à la clé des économies d’eau», affirme Alexandre Martin, directeur général délégué d’Aquaprox, qui cite par exemple un grand parc de loisirs en région parisienne. Son homologue Eco2 Protect B, destinée aux chaudières, présente les mêmes avantages (produits biosourcés, économies de gaz et d’eau) et bénéficie également de nombreuses références. Eco Protect S a pour sa part été utilisé pour régler des problèmes d’encrassement et corrosion des pasteurisateurs.
Cette solution biosourcée
peut être couplée avec un générateur
de chlore Eco2
Cell pour la désinfection.
La formulation complexe (oxydants,
correcteurs de pH, agents antitartre,
anticorrosion, biodispersants…) des
produits destinés aux TAR résulte peut être d’une attention insuffisante portée
au filtrage initial, donc à la lutte contre
l’encrassement. C’est en tout cas ce que
soutient Jérémie Machémy (Evoqua),
indiquant que certains pays vont bien
au-delà des simples filtres à sable généralement utilisés en France, pour arriver à des filtres au micromètre. Johann
Scuiller (Hydrex®) le rejoint, au moins
en partie, soulignant qu’un traitement
réussi résulte de la combinaison de plusieurs facteurs… dont la filtration.
C’est pour faciliter le mode opératoire
de désinfection que Babcock Wanson
Water recommande d’ailleurs la mise
en place de contrats de maintenance
dont la prestation intègre les consommables, le service, la télésurveillance,
les reporting de fonctionnement et la
gestion des dérives.