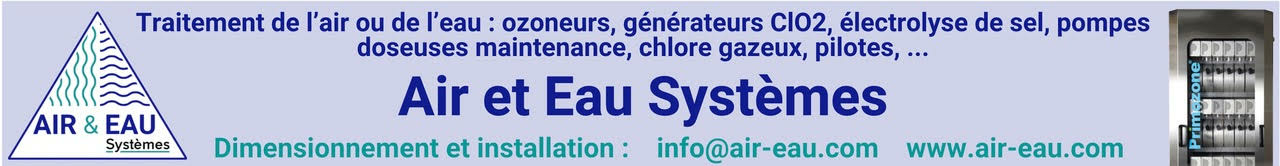Réutiliser les eaux usées après traitement est parfaitement possible d’un point de vue technique. La REUT marque pourtant le pas en France, malgré une réglementation désormais complète. Petit tour d’horizon des conditions de réussite des projets (ou des raisons d’échec)…
En avril 2023, le gouvernement lançait son Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, plus connu sous le nom de « Plan Eau ». La sécheresse de l’année précédente avait en effet alerté sur les limites d’une ressource jusque-là considérée comme abondante en France. Parmi les 53 mesures annoncées figurait la massification de la valorisation des eaux non conventionnelles, ce qui comprend, entre autres, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT).
Deux ans après, force est de constater que le compte n’y est pas : la France n’utilise que 1 % de son potentiel de REUT, bien loin des 10 % visés en 2030. De nombreuses collectivités s’y intéressent, certes, mais la plupart des projets de REUT n’aboutissent pas. Les réalisations, surtout à une échelle significative, restent exceptionnelles. Pourquoi ? Quelles sont les conditions de réussite de ce type de projet, ou a contrario les obstacles ? Le Cerema a édité début 2025 un guide consacré justement à ces questions du pourquoi, du comment et des conditions de réussite : « Eaux usées traitées. Une ressource à valoriser ». Signe sans doute que cela ne va pas de soi…
C’est peut-être là que tout se joue. Avant même d’envisager les questions réglementaires, techniques et économiques, il s’agit «tout simplement» de s’assurer de la pertinence du projet et de son insertion territoriale. Olivia Martin, directrice de projet Plan Eau au Cerema, le souligne : «Nous préconisons une réflexion territoriale partant du besoin. Identifier les zones en tension sur la ressource en eau, les besoins des usagers, puis recenser quelles solutions sont possibles sur le territoire : REUT, récupération des eaux de pluie, utilisation des eaux grises, etc. Il est également essentiel de rester dans une logique de sobriété des usages et de substitution aux prélèvements existants. La REUT ne doit pas être vue comme une ressource supplémentaire par rapport aux prélèvements actuels.»
RÉFLEXION TERRITORIALE ET CONCERTATION
Le retour d’expérience accumulé par le Cerema sur de nombreux projets, abandonnés ou non, démontre également l’importance de leur gouvernance. «Ces projets sont des sujets d’aménagement du territoire et doivent être envisagés en concertation avec l’ensemble des acteurs : la collectivité porteuse, les services financeurs (agences de l’eau, Europe, régions…), les services instructeurs, avec lesquels mieux vaut échanger en amont de la demande d’autorisation, et l’ensemble des usagers et bénéficiaires. Cela assure le coportage des projets et permet, éventuellement, d’en partager les coûts (Capex ou Opex)», ajoute-t‑elle.
À titre d’illustration de cette démarche, elle cite l’exemple de Château-Renault , une petite ville rurale d’Indre-et-Loire. À l’occasion de la reconstruction de sa STEU, qui rejette ses effluents dans la Brenne, une rivière fragile, la municipalité a envisagé une REUT. Les rejets de la STEU étant très limités en période chaude (mai à octobre) pour préserver la qualité de la Brenne, une grande partie des effluents est désormais dirigée, via une canalisation de relèvement, vers une lagune de finition. Il en sort une eau de qualité suffisante pour l’irrigation de céréales par aspersion.
A la sortie de la lagune, une station de pompage peut envoyer environ 700- 800 m3 /j vers un réseau d’irrigation. La STEU et la lagune ont été financées par la ville, l’Agence de l’eau et le département. Deux agriculteurs voisins qui utilisent cette eau assument le coût énergétique du pompage. Ils ont bien sûr réalisé à leurs frais leur réseau d’irrigation. Une réussite due à la concertation initiale entre la commune, les agriculteurs concernés, le délégataire (en l’occurrence Veolia) et les services de l’Etat, qui y trouvent tous un intérêt. Un exemple similaire est celui de la REUT agricole à Mauron dans le Morbihan.

«Afin de réduire son impact sur le milieu récepteur fragile (le Doueff et l’Yvel alimentant le Lac au Duc) situé en zones sensibles (Natura 2000, ZNIEF), l’arrêté préfectoral a imposé à la STEU du Bois de la Roche de réduire son rejet de 50% en période d’étiage.
En 2008, le recours à la REUT pour de l’irrigation agricole, en substitution du rejet dans le Doueff, a donc été préconisé et très favorablement accueillie par un groupement d’agriculteurs locaux.
Ils trouvèrent là une ressource durable et pérenne pour leurs 100 ha de parcelles, grâce à une lagune de décontamination “naturelle” et de stockage de 15000 m3 », a rappelé Frédérique Nakache-Danglot, référente REUT et cheffe de service Expertise Process et Microbiologie pour le groupe Saur, lors du congrès 2025 de l’Astee à Toulouse. A l’issue de travaux d’extension, de mise en conformité et d’instruction du dossier de demande d’autorisation (DDA) de REUT, la commune de Mauron, puis Ploermel Communauté ont pu inscrire la station du Bois de la Roche parmi les neuf STEU de Bretagne autorisées à livrer leurs EUT à des agriculteurs.
«Comme pour Château-Renault, ce cas de REUT a pu être autorisé par les services de l’Etat en un peu plus d’un an – cela est exceptionnel – grâce au double enjeu (environnemental et agricole) et à la synergie d’actions menées par les différents acteurs (les services de l’état, les usagers, la collectivité et son délégataire Saur)», a poursuivi Frédérique Nakache-Danglot. Cela ne se passe pas toujours ainsi, comme en témoigne par exemple Cyrille Charbonnier, chef de marché de l’activité Eau en France chez Suez. «Les collectivités sont motivées par des considérations de stress hydrique, mais le moteur réel de la REUT est l’utilisateur prêt à payer. Or on va souvent le chercher dans un deuxième temps: il n’est pas associé à l’origine de la réflexion», regrette-t‑il.
LOURDEUR ADMINISTRATIVE
C’est l’obstacle spontanément cité par tous les interlocuteurs : la constitution du dossier et les démarches de demande d’autorisation restent en général très lourdes. Les projets doivent obtenir une autorisation préfectorale, après instruction par les services en charge de l’environnement et de la santé, entre autres. Avec, de plus, une modalité particulière: une absence de réponse au bout de six mois vaut refus. Les municipalités ne disposent pas des compétences nécessaires pour cela et font appel à des bureaux d’études spécialisés, comme par exemple Ecofilae, Gaxieu ou DV2E.
En situation de DSP, le délégataire peut aussi apporter conseils et aide. «Notre division Consulting chez Suez peut faire des études d’opportunité, définir des usages, vérifier la faisabilité technique, économique et réglementaire d’un projet», explique ainsi Denis Snidaro, directeur technique adjoint de l’activité Eau en France chez Suez. «Avec les décrets de 2023, le cadre réglementaire est maintenant complet et cohérent mais le montage des dossiers reste très lourd», estime-t‑il.
«La dimension réglementaire reste le premier obstacle. Elle est un peu allégée depuis le Plan Eau, mais il faut toujours démontrer l’innocuité environnementale et sanitaire du projet, ce qui peut faire peur», abonde Pierre Rousseau, directeur marketing, communication et digital pour la France et la Suisse chez OTV, la branche construction de Veolia Water Technologies. Antoine Legrand, directeur commercial de Sources, confirme cet état de fait: «Une seule chose a vraiment changé : l’éventuelle autorisation qui auparavant n’était valable que pour cinq ans – donc aucune collectivité ne désirait investir dans un tel outil – est désormais définitive. La démarche reste cependant très lourde et la clause du “non” par défaut envoie un mauvais message. Les ARS5 s’appuient sur le principe de précaution, or la REUT se pratique dans des pays voisins sans aucun problème sanitaire».

«Nous voyons arriver beaucoup de demandes mais peu aboutissent à cause de la lourdeur administrative», déplore également Nicolas Meudal, fondateur de 1h2o3. Même constat encore du côté de Kamal Rekab, responsable R&D chez UVRER: «La partie réglementaire et les exigences en matière de sécurité allongent considérablement les délais de mise en œuvre. Nous espérons à l’avenir une simplification des démarches pour faciliter l’accès à ces solutions innovantes et durables pour les utilisateurs.»
QUELLE EAU POUR QUELS USAGES ?
Une eau usée traitée peut être réutilisée pour l’irrigation agricole, pour une activité industrielle ou pour des usages urbains comme l’arrosage des espaces verts, le nettoyage des voiries ou l’hydrocurage du réseau d’assainissement. Les décrets de décembre 2023 ont défini différents niveaux de qualité d’eau (A, B, C ou D) correspondant à différents usages. Sont mesurées : les matières en suspension (MES), la demande biologique en oxygène (DBO5), la turbidité et la qualité microbiologique (E. Coli, spores de C. perfringens et coliphages somatiques).
«Les projets de REUT multiusages sont facilités par la nouvelle réglementation qui met en cohérence les exigences de qualité d’eau pour diverses utilisations, alors qu’auparavant c’était un peu “siloté”. Les “mesures barrières” édictées dans les décrets permettent en effet d’utiliser la même qualité pour plusieurs usages», souligne Olivia Martin (Cerema). Par exemple, si l’arrosage par aspersion des espaces verts en présence de public requiert une eau de qualité A, il est possible d’utiliser une eau de classe B en dehors des heures d’ouverture, ou en prenant des mesures pour éloigner le public durant l’aspersion.
«En effet, les cas les plus historiques sont ceux des communes littorales du grand Ouest, rappelle Frédérique Nakache Danglot (Saur), avec notamment l’Île de Noirmoutier en Vendée, où Saur inaugurait en 1982, aux côtés de la Communauté de communes de l’Île, l’une des premières installations de REUT agricole en France. En l’absence de ressources hydriques in situ, la collectivité avait fait le choix de cette ressource pérenne pour l’irrigation de cultures maraîchères, dont les “Pommes de terre Bonotte de Noirmoutier” IGP. Depuis plus de quarante ans, entre 300000 et 500000 m3 sont ainsi réutilisés en irrigation, à partir d’un système lagunaire profitant de l’irradiation solaire pour décontaminer l’eau stockée».
Une autre belle référence en REUT mutiusages (agricoles, espaces verts, stades et même centres équestres) est pratiquée depuis plus de 17 ans sur l’Île de Ré par quatre STEU exploitées par Saur pour le compte des communes locales, dont la STEU de la Flotte en Ré avec sa lagune des irrigants de 12000 m3 fournissant, à elle seule, 30000 à 50000 m3 par an d’EUT, entre autres pour les pommes de terre primeurs de l’île et pour les vergers et autres cultures maraîchères. Historiquement, avant l’apparition de ces décrets, la plupart des projets réalisés – l’Observatoire national des services d’eau et d’assainissement en a recensé environ 170 à ce jour – étaient dédiés à l’irrigation agricole ou à l’arrosage de golfs.
Il est encore trop tôt pour établir des statistiques significatives sur les éventuels changements d’usage depuis la mise en place de la nouvelle réglementation. «En général, on en reste à des usages “simples” comme le traditionnel arrosage des golfs et aires de loisir, et maintenant l’arrosage des espaces verts municipaux. L’usage agricole n’est pas assez répandu malgré les risques de pénurie. On nous demande parfois maintenant de mettre en place un traitement simple pour alimenter un réservoir sur lequel les camions nettoyeurs ou hydrocureurs municipaux viennent se recharger, mais cela reste mineur», estime ainsi Pierre Rousseau (OTV | Veolia Water Technologies).
«Nous avons quelques installations opérationnelles depuis plusieurs années. La première, qui date d’une quinzaine d’années, est à Bora Bora, une île en stress hydrique sévère. L’eau de REUT y sert à l’arrosage des espaces verts. Le golf d’Agde est également arrosé avec de l’eau usée traitée depuis quelques années, et la STEU de Carré de Réunion, à Saint-Cyr-l’École pour l’agglomération de Versailles, pratique la REUT pour l’arboriculture. Au total, nous avons quatre ou cinq réalisations opérationnelles et un certain nombre de projets en cours, essentiellement pour l’arrosage des espaces verts municipaux», recense pour sa part Denis Snidaro pour Suez.
Le projet plus récent de Salher visait à traiter les eaux usées domestiques générées par un campus d’étudiants au Nigeria. Il s’agissait d’intégrer, à la ligne de traitement de base – une station d’épuration (STEP) d’une capacité de 10 000 équivalents-habitants (EH) –, un système de réutilisation pour l’irrigation des espaces verts du complexe. Pour ce projet EPC, le système de REUT retenu est une ultrafiltration par des membranes à haut rendement de Sahler. «Ces dernières années, l’engagement en faveur de ce type de solution de réutilisation des eaux traitées a connu une croissance exponentielle. Les responsables de la mise en œuvre de tels projets commencent à tenir compte de l’avis des experts en environnement et des entreprises de traitement de l’eau, et ajoutent à leurs STEP une phase de réutilisation, dont le coût est inférieur à l’impact environnemental de sa mise en œuvre», constate Cristina Alda, responsable marketing chez Sahler.
«Nous voyons aujourd’hui très clairement une recrudescence des demandes chez les industriels qui sont sensibles à leur consommation (empreinte environnementale) et/ou à des contraintes sur leur volume de rejet journalier. Ces contraintes les obligent à réutiliser une partie de leurs eaux de sortie de station d’épuration, soit dans leur process (industrie textile, par exemple) soit pour des aires de lavage (industrie agroalimentaire)», constate Christophe Dedieu, directeur général de KWI.
La société a installé, il y a déjà près de 20 ans, des filtres à sable à lavage continu en sortie de la STEP municipale de Sainte-Maxime (Var) pour l’arrosage d’un golf. KWI intègre ses solutions – élimination des matières en suspension (via membranes ou filtration), puis désinfection (UV et/ou chloration) – soit en amont, lors de la construction des STEP industrielles, soit a posteriori, par exemple en livrant des unités conteneurisées Plug & Play. Sources a récemment reconstruit la STEU de Lunel (Hérault).
«La filière comprend un traitement tertiaire et une désinfection UV pour les effluents (600 m3 /h) qui sont rejetés en mer. Il est prévu d’en utiliser une partie pour le lavage des voiries, mais, surtout, la municipalité est en attente d’autorisation pour l’irrigation d’un parc botanique proche de la STEU», précise Antoine Legrand. Sources cite également une réalisation à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain). «C’est le cas de figure le plus fréquent: ils ne traitent et réutilisent qu’une petite partie (20 m3 /h) des effluents.
Comme la STEU dispose déjà d’un traitement tertiaire pour des raisons de fragilité du milieu récepteur des effluents, il a suffi d’ajouter un réacteur UV pour la désinfection. Les eaux traitées sont stockées dans une cuve et les camions municipaux viennent se servir», détaille Antoine Legrand. Dans les appels d’offre, Sources – à l’instar des autres constructeurs – voit souvent des demandes d’aménagement optionnel: conserver une emprise sur le site de la STEU pour installer éventuellement ce genre de système (traitement final, stockage et distribution). La société a par exemple remporté l’appel d’offre pour la STEU de Montaud (Hérault) comprenant une tranche optionnelle de ce type.

Bio-UV Group fabrique des réacteurs UV de toutes tailles et puissances. La société a ainsi participé aux projets de Béziers (Hérault; 50 m3 /h destinés à l’arrosage des espaces verts et possiblement au nettoyage de la voirie), Saint-Cyprien (Pyrénées Orientales ; environ 300 m3 /h pour l’irrigation agricole) ou Cannes (usages urbains), ainsi qu’en Corse et à la Grande-Motte (Hérault) pour l’arrosage de golfs.
«Nos clients sont des intégrateurs qui associent nos réacteurs aux filières de traitement. Cependant, pour des débits de 5 à 10 m3 /h, nous proposons le Cubiq, un skid complet Plug & Play qui intègre pompe, filtre et UV», précise Robin Degrave, Mangager R&D chez Bio-UV Group.
«Les trois quarts des demandes que nous recevons concernent des débits inférieurs à 10 m3 /h», remarque pour sa part Nicolas Meudal (1h2o3), dont la société fabrique précisément des systèmes intégrés de cette taille. Ces petits débits de 5 à 50 m3 /h sont souvent réclamés dans les projets REUT, notamment lorsqu’il s’agit de REUT multiusages. Frédérique Nakache-Danglot (Saur) rappelle que «le groupe a mené des essais R&D en conditions réelles sur site, motivés par la nouvelle réglementation de décembre 2023 et des arrêtés à venir [voir encadré page 69].
Entre fin 2023 et début 2024, trois skids REUT de première génération à étapes classiques de désinfection d’EUT (filtration mécanique et irradiation UV), construits par 1h2o3 et Nijhuis, filiale de Saur, ont été testés sur deux STEU situées dans l’Hérault et exploitées par Saur pour Montpellier Méditerranée Métropole. Ni la qualité A, ni la qualité B n’ont été respectées au cours de ces premiers essais, la qualité B ne l’étant que sous condition de charge des eaux à tester et de doses UV appliquées».

C’est la raison pour laquelle ces essais se poursuivent cette année sur les mêmes skids avec l’optimisation du réacteur UV afin de garantir la qualité B. En parallèle, d’autres skids de deuxième génération à étages membranaires (UF, voire UF/ OI…) précédés d’une filtration granulaire et complétés, le cas échéant, par des étapes d’affinage (charbon actif, UV, chloration…) sont en cours d’essais en conditions réelles afin de garantir la qualité A.
«Nous pouvons ainsi proposer une offre élargie de solutions REUT en termes de faisabilités technique et économique, aussi bien pour les collectivités que pour les industriels, avec la possibilité d’atteindre des exigences de qualité plus poussées, par exemple en visant également l’élimination des micropolluants, comme la Suisse l’exige dans sa réglementation en assainissement», affirme Frédérique Nakache-Danglot.
«L’ozone est un oxydant puissant particulièrement efficace dans le cadre de la REUT. Il permet de dégrader un large spectre de polluants tels que pesticides, résidus pharmaceutiques, composés organiques réfractaires, phénols, nitrites, sulfures ou encore micro-polluants émergents. Le principal avantage de l’ozone réside dans son mode d’action sans réactif ajouté : aucune production de boues, ni de résidus chimiques persistants, et aucune nécessité de stockage ou de transport de consommables. L’ozonation améliore aussi la transparence de l’eau et son odeur, tout en assurant une désinfection efficace contre les virus, bactéries et protozoaires. Ce traitement tertiaire avancé s’intègre parfaitement dans une démarche durable de REUT, notamment pour les usages agricoles, urbains ou industriels», explique Quentin Vigoureux, responsable développement commercial chez Oxytrading.
«Nous travaillons de plus en plus sur des projets de REUT, en réponse à une demande en forte croissance. L’augmentation des besoins en eau et la nécessité de solutions durables renforcent l’intérêt pour ces projets, où l’ultraviolet (UV-C) s’impose comme la technologie optimale pour assurer une désinfection efficace avant utilisation ou stockage. Nos projets portent principalement sur des applications de lavage et d’arrosage, avec notamment une réalisation récente destinée à l’arrosage de terrains de golf à l’étranger. En parallèle, plusieurs projets sont en cours en France et devraient voir le jour d’ici fin 2025», annonce Kamal Rekab (UVRER).
GROS VOLUMES : D’AUTRES QUESTIONS SE POSENT
Les usages agricoles ou industriels exigent pour leur part des débits importants, et impliquent de traiter l’intégralité – ou une partie significative – des effluents de la STEU. «L’intérêt de la REUT est précisément de pouvoir viser des volumes importants, avec certains usagers prêts à contribuer financièrement. Il faut alors souvent recenser l’ensemble des besoins sur un territoire, autant que possible à proximité de la STEU, et monter un projet multiusages», recommande Olivia Martin (Cerema).
«Notre projet le plus significatif en France est à Nice, à l’occasion de la remise à niveau de la STEU. La métropole veut réutiliser (à partir de 2028) environ 5 millions de m3 /an d’eau usée traitée pour son réseau d’eau non potable, historiquement alimenté par la Vésubie. Cette eau est soit vendue (industrie ou agriculture) soit utilisée pour le nettoyage de voirie ou l’arrosage des espaces verts. Les autres grandes réalisations sont inférieures d’un ordre de grandeur. Et la plupart des autres projets se comptent plutôt en dizaines de milliers de m3 annuels, soit quelques m3 /h», précise Cyrille Charbonnier pour Suez.

Les systèmes mobiles de traitement d’eau offrent également des possibilités intéressantes en matière de REUT, comme l’a démontré une raffinerie du nord-ouest de l’Allemagne qui s’est associée à Nijhuis Saur Industries (NSI) Mobile Water Solutions pour faire face à la pénurie d’eau régionale et respecter des réglementations de rejet strictes.
«Le projet a abordé la réutilisation des eaux usées de la station d’épuration interne de la raffinerie, en intégrant une technologie avancée d’ultrafiltration avec un dosage d’hypochlorite de sodium en amont et une filtration sur charbon actif en aval, complétée par une unité mobile d’osmose inverse.
Cette approche a permis à la raffinerie de réutiliser une part significative des effluents de sa STEU, respectant ainsi des normes environnementales strictes tout en soutenant les initiatives “water positive” de l’entreprise», explique Rina Hauroo, Marketing Manager Europe chez NSI Mobile Water Solutions.
Séché Traitement des eaux industrielles (STEI) a développé une unité mobile ReUse/PFAS pour les industriels. Lorsqu’un industriel a un projet de REUT, cette unité permet de réaliser des essais pilotes sur site pour définir le traitement le plus performant en fonction de la qualité d’eau souhaitée. Cette solution sur mesure permet de tester plusieurs combinaisons de technologies (préfiltration, filtration membranaire, adsorption sur charbon actif et/ou résine échangeuse d’ions…).
Intégrée dans un conteneur 40 pieds, l’unité est prête à être déployée sur site en mode « plug and play ». Les industriels peuvent ainsi comparer différentes filières de traitement et valider les meilleures technologies pour garantir la qualité d’eau visée. A la fin de l’essai, STEI est alors capable de dimensionner précisément une solution pérenne, son Capex et ses Opex, pour proposer la construction d’une installation clés en main.
Sans que l’on sache à l’heure où nous mettons sous presse qui l’emportera, signalons également l’appel d’offre d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), où l’intégralité des effluents de la STEU (600 m3 /h) sera traitée et réutilisée pour de l’irrigation agricole. Réutiliser l’intégralité, ou une part importante, des effluents d’une STEU peut cependant poser un problème environnemental, lorsque lesdits effluents soutiennent le débit d’étiage du cours d’eau où ils sont déversés. C’est un autre frein au développement des projets.
«La REUT intégrale est pertinente pour les STEU déversant directement en mer, puisque la question du soutien d’étiage ne se pose pas. De plus, en zone côtière, les eaux usées subissent souvent un traitement initial poussé, allant jusqu’à la désinfection, lorsque le rejet se fait en zone conchylicole ou de baignade. On obtient, dès la sortie de la STEU, des eaux d’une qualité proche de celle nécessaire pour des usages agricoles ou communaux», affirme Antoine Legrand (Sources).

C’est pourquoi le Plan Eau de 2023 comportait le lancement d’un «appel à manifestation d’intérêt spécifique à destination des collectivités littorales pour étudier la faisabilité de projets de REUT», copiloté par l’Association nationale des élus des littoraux (Anel) et le Cerema. «L’idée est à la fois de réduire les rejets en zones sensibles (baignade, conchyliculture), de lutter contre biseau salé en réduisant prélèvements en nappe, et de faire face à l’afflux de population estivale en suppléant l’usage d’eau potable par de la REUT.
Le Cerema soutient les études d’opportunité», explique Olivia Martin, qui pilote aujourd’hui le programme. Anaïs Nouet, ingénieure cheffe BET AEP – EU – REUT chez Gaxieu Béziers, confirme les dires d’Antoine Legrand en ajoutant que «le département de l’Hérault s’est d’ailleurs doté d’une doctrine indiquant clairement sur quelles communes la REUT est envisageable ou non. C’est, à ma connaissance, le seul département à avoir fait cette démarche.
Si la mise en œuvre de la REUT est donc plus adaptée sur les secteurs littoraux, l’éventuelle présence de sels dans les effluents, compte tenu des intrusions d’eau claires parasites permanentes, ne permet pas la mise en place de projet d’irrigation. Or les projets d’irrigation sont ceux qui permettent de mobiliser aujourd’hui les volumes plus importants (et donc de trouver des équilibres financiers). La mise en place de la REUT est donc très étroitement liée au fonctionnement et à la gestion du système d’assainissement dans sa globalité».
Traiter de l’eau usée pour atteindre les niveaux de qualité réglementaires (surtout le A), l’analyser régulièrement, l’acheminer vers les utilisateurs, tout cela a un prix. Hors situation d’urgence hydrique, c’est un obstacle souvent insurmontable. «L’eau usée traitée reste plus chère que l’eau potable classique. L’accélération de la REUT ne se produira que lorsqu’il n’y aura plus le choix pour des raisons de pénurie», résume ainsi Antoine Legrand (Sources).
«Aujourd’hui le coût de l’eau potable n’est pas assez élevé pour justifier la REUT. Donc seules les communes réellement motivées se lancent. C’est par exemple le cas dans les Pyrénées-Orientales où les collectivités sont menacées de pénuries d’eau. De plus, leurs STEU déversent en mer, ce qui facilite l’autorisation des projets», concoure Robin Degrave (Bio-UV Group).
LA DIFFICILE ÉQUATION ÉCONOMIQUE
«Le niveau de qualité A est tellement difficile à atteindre que cela revient très cher par rapport à l’eau potable. Cela demande de plus des technologies assez délicates à opérer et maintenir, ce qui fait reculer des petites collectivités qui n’ont pas le personnel compétent pour cela. Nous ne répondons d’ailleurs plus qu’aux demandes pour de l’eau de qualité B, C ou D», affirme pour sa part Nicolas Meudal (1h2o3).
Pierre Rousseau (OTV | Veolia Water Technologies) plaide donc pour une révision des prix. «Aujourd’hui, faire de la REUT coûte potentiellement plus cher que produire de l’eau potable. Donc comment fixer les prix ?», s’interroget‑il. L’équation est encore plus difficile à résoudre pour l’irrigation agricole, qui n’utilise pas d’eau potable.
«Le principal utilisateur massif potentiel d’eau usée traité est l’agriculture. Or en France, l’immense majorité des agriculteurs a accès à des volumes d’eau considérables pour un prix très faible», souligne ainsi Cyrille Charbonnier (Suez). Le coût de traitement de l’eau usée ne représente qu’une partie du problème. Reste encore à l’acheminer vers les utilisateurs, ce qui peut nécessiter des investissements importants. Qui va les assumer : la collectivité opérant la STEU ou les utilisateurs d’eau traitée ?
«La distance entre la STEU et les utilisateurs est un frein important. Même pour l’arrosage des espaces verts, un camion municipal peut se recharger aux bouches d’incendie ou aux robinets de puisage, sans devoir aller jusqu’à la STEU, en général éloignée du centre-ville. Pour les usages massifs en agriculture ou en industrie, la question est encore plus difficile puisqu’il faut poser une canalisation», souligne Pierre Rousseau (OTV | Veolia Water Technologies). Il cite l’exemple de Loudéac (Côtes-d’Armor) où l’eau de REUT est utilisée à des fins industrielles.
«Nous avons pu le faire car la zone industrielle est implantée à côté de la STEU, qui est d’ailleurs une STEU mixte municipale-industrielle», explique-t‑il. Beaucoup d’irrigations de golfs par eau usée traitée ont également été rendues possibles par la proximité de la STEU, ainsi à Sainte-Maxime (Var) ou Pornic (Loire-Atlantique). C’est la même situation qui a permis à Veolia d’irriguer Disneyland à Marne-la-Vallée avec les effluents traités de la STEU du parc. «La question du financement des travaux pour l’acheminement de l’eau de REUT vers son usage freine beaucoup de grands projets», résume Denis Snidaro pour Suez.
Parmi les réalisations historiques, le Cerema cite volontiers l’exemple de l’île de Porquerolles (Var), où des vergers sont irrigués avec de l’eau usée traitée – par lagunage puis filtration sur sable. Un coup d’œil sur la carte de l’île suffit pour constater que les parcelles irriguées sont situées juste à côté de la STEU et des lagunes. C’est ce qui a rendu le projet possible. Epur, filiale de Veolia, a, elle aussi, plusieurs réalisations à son actif dans le cadre du projet Irri-Alt’Eau.
Pour assurer la pérennité de certaines exploitations viticoles et économiser l’eau dont les volumes ne cessent de diminuer au fur et à mesure des différents épisodes de sécheresse, la micro-irrigation des vignobles par de l’eau usée traitée est devenue une solution pertinente. S’appuyant sur une filtration GAROFiltre (composé de granulés de verre recyclé) de Gaches Chimie, cette solution testée depuis 2012 par un consortium de R&D intégrant collectivité (communauté d’agglomération Grand Narbonne), acteurs de la recherche (Inrae, laboratoire LBE), entreprises privées (Veolia, Aquadoc, la Cave de Gruissan) et un accompagnement par Ad’Occ (Région Occitanie) est aujourd’hui éprouvée.
Elle a ainsi été déployée à Perpignan (Pyrénées-Orientales), Agay (Var), Villefranchesur-Saône (Rhône) et Saint-La-Chapelle Saint-Mesmin (Loiret). Le Plan Eau aurait-il fixé des objectifs de REUT trop ambitieux, ou prématurés? La REUT serait-elle inadaptée à la situation française – qui est encore loin du stress hydrique de l’Espagne, souvent évoquée à titre comparatif (sans parler d’Israël)? La concentration des réalisations et des projets agréés dans les zones aujourd’hui en stress hydrique – Pays de la Loire, Vendée, Languedoc… – suggère au contraire qu’il faut s’y préparer. «L’expérience accumulée sur les petits projets de REUT pour usages urbains sera très utile pour les grands projets à venir», estime ainsi Cyrille Charbonnier (Suez).