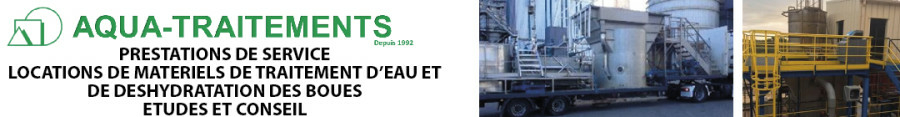Confrontés à des restrictions de prélèvement en période de pénurie d'eau, les industriels envisagent le recyclage ou la réutilisation de la ressource. Si tout est – techniquement – possible, certaines options sont plus réalistes que d'autres. Petit tour d’un marché qui, attentiste durant deux années – relativement – pluvieuses, semble aujourd’hui repartir à la hausse.
Tous les sites industriels ou presque consomment de fortes quantités d'eau. Cette dernière est indispensable au procédé lui-même à différents titres selon la branche, évidemment comme aux utilités (chaudières, tours aéroréfrigérantes...). Les éventuelles restrictions préfectorales sur le prélèvement en période de pénurie d’eau peuvent donc signifier une diminution, voire un arrêt, de la production du site.
Après avoir optimisé leur procédé pour consommer le moins possible, les industriels se tournent donc depuis quelques années vers le recyclage d'une partie de l'eau après utilisation au sein même du procédé on parle alors de « boucles courtes », voire vers la réutilisation des effluents de leur station d’épuration (STEP) on parle alors de « réutilisation des eaux usées traitées » ou REUT.
Comme le rappelle Vivlo, la REUT existe dans la gestion des eaux industrielles depuis plus de 30 ans mais la prise de conscience du réchauffement climatique change les mentalités. Encore plus lorsque cette prise de conscience s’accompagne de restrictions de pompage pour les industriels.
Les stress hydriques constatés dans certaines zones ces dernières années accélèrent la gestion de l'eau par la REUT. L'eau n’était pas considérée au même titre que l’énergie, car les coûts et contraintes associés n’étaient pas significatifs à l'échelle des sites de production. Même si le coût de l'eau reste très raisonnable en France, la dépendance et un risque de coupure d’approvisionnement rendent très attractive la réutilisation des eaux usées traitées.

Pour cela, les industriels font appel à des traiteurs d'eau spécialisés (Acqua.ecologie, Aquaprox I-Tech, Atlantique Industrie, Babcock Wanson, Bio-UV Group, BWT, Chemdoc, Evoqua [groupe Xylem], ExoCell, Gemad, ICE Water Management, InovaYa, John Cockerill, KWI, Nereus, Nitto Hydranautics, Vivlo ou Waterleau, par exemple) ou à de grands généralistes ayant une branche industrielle, comme Nijhuis Saur Industrie ou Veolia. Des chimistes produisant des réactifs de traitement se sont également lancés dans la fourniture d’installations de recyclage complètes, à l'instar d’Adiquimica, de Nalco Water (groupe Ecolab) ou d’Odyssée Environnement.
Il est aujourd'hui techniquement possible de retraiter n’importe quel effluent, aussi pollué soit-il, pour obtenir, au final, n'importe quelle qualité d'eau souhaitée. Il suffit de s'en donner les moyens en termes d'investissement, d’énergie, de réactifs ou de main-d'œuvre qualifiée…
Une démarche plus réaliste consiste à déterminer pour chaque site quels sont les besoins « quelle qualité d'eau pour quel usage ? » et à voir s'il est possible d'y répondre, au moins partiellement, à partir d'un effluent intermédiaire (boucle courte) ou final (REUT), moyennant un traitement « raisonnable ». Des associations professionnelles ont d'ailleurs édité des guides pour aider les industriels dans leur démarche, comme le Comité stratégique de filière Eau ou l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires.

« Avant d'aborder le sujet de l’investissement, il faut parler de cartographie. Toutes les eaux ne se valent pas : leur qualité, leur disponibilité et leur coût de traitement diffèrent. Nous accompagnons les industriels dans cette phase de “comptabilité hydrique”, à savoir identifier où l'eau est utilisée, où elle peut être récupérée, et à quel prix. Réutiliser une eau de rinçage peut coûter dix fois moins cher qu'un effluent final de station d’épuration. La clé est de hiérarchiser les boucles selon leur rentabilité et leur sécurité sanitaire. Cette approche pragmatique concentre les efforts sur les usages à plus fort impact économique et environnemental », explique Jamal Ouidirene, directeur commercial d'ICE Water Management. Cependant d'autres contraintes variables selon les branches industrielles, la réglementation, la réalité économique restreignent en fait l’univers des possibles.
CHAUD ET FROID : DES BESOINS COMMUNS

Sans même parler de procédé, beaucoup de sites, quelle que soit la branche industrielle, utilisent de l'eau pour faire du chaud ou du froid. Les chaudières de production de vapeur et les tours aéroréfrigérantes (TAR) consomment d’importantes quantités d'une eau qui n'a certes pas besoin d’être potable mais qui doit tout de même respecter certains critères de qualité.
« Les chaudières exigent à minima une eau adoucie (débarrassée du calcaire) et fortement déminéralisée. Nous essayons, autant que possible, de la produire à partir du recyclage des condensats de vapeur dans le système de chauffage lui-même : c'est une eau déjà chaude et déminéralisée.
Nous cherchons également si d'autres condensats sont disponibles sur le site, en utilisant notre expertise de la séparation vapeur-condensat. Faire de l’eau pour chaudière à partir d’eau de procédé (de lavage, par exemple) est plus délicat : il faut éliminer l’éventuelle pollution organique, par voie biologique ou en utilisant des membranes spécifiques ou du charbon actif. Cela se fait donc surtout dans les industries produisant peu ou pas de matière organique", explique David Gautier, directeur commercial chez Nalco Water.
La technologie du charbon actif, telle qu’elle est utilisée dans les solutions de filtration mobile durable de Desotec, permet d’éliminer ou de réduire de nombreux composants comme la demande chimique en oxygène (DCO), les BTEX (composés organiques volatils regroupant le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et le xylène), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les halogènes organiques adsorbables (AOX), les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), les détergents, les savons, les solvants, les micropolluants, etc.
« Les TAR sont moins exigeantes : on peut donc recycler de l’eau du procédé (eau de rinçage final, par exemple), de l’eau de refroidissement, de l’eau de concentration de la matière laitière, etc. », ajoute David Gautier. Il faudra cependant ajouter des produits antitartre et anticorrosion, et prendre en compte le risque bactérien (légionelles essentiellement).
Nalco a par exemple réalisé ce type d’installations dans une laiterie bretonne, région très affectée par la sécheresse. Les eaux de process, auparavant rejetées dans le milieu après épuration, sont désormais directement redirigées vers la TAR, après désinfection. L’exploitant économise ainsi 15 000 m³ d’eau par an, et de plus soulage sa station d’épuration. Nalco cite également volontiers sa réalisation sur le site Cargill de production d’huile alimentaire, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Là, c’est l’effluent de la STEP qui est traité et réutilisé pour la TAR, à raison de 30 000 m³ par an.

« En industrie, la production de chaud ou de froid représente souvent un volume important des prélèvements d’eau. Or le recyclage est relativement “facile” pour ces utilités car l’eau n’y est pas soumise à des normes sanitaires », explique pour sa part Étienne Fiquet, Market Development Manager chez Veolia. La société a ainsi réalisé une installation de REUT sur un site du pâtissier Pasquier. Les effluents de la STEP, après traitement complémentaire, sont dirigés vers les condenseurs, qui étaient auparavant alimentés par de l’eau de ville osmosée. « Cela a permis de diminuer de 85 % la consommation d’eau d’appoint des condenseurs, donc de 51 % celle du site. Ils utilisent le froid pour surgeler leurs pâtisseries », précise Étienne Fiquet.
« Dans l’agroalimentaire, on recycle aussi souvent des condensats d’évaporateurs. Les sucriers et les laitiers, en particulier, sont de grands producteurs d’eau issue d’évaporation ou de concentration des matières premières. Il suffit d’un traitement simple (charbon actif ou chimie avec filtration) pour réutiliser ces eaux dans les TAR ou les chaudières. Comme, de plus, elles sont déjà chaudes, cela diminue la consommation d’énergie des chaudières. Pour l’utilisation en TAR, on récupère au préalable les calories via un échangeur de chaleur », détaille Frédéric Fuhrmann, spécialiste du recyclage et de la réutilisation chez Veolia. Desotec intervient sur ce type d’applications en fournissant des filtres mobiles qui s’adaptent à différents environnements, et qui peuvent être combinés à plusieurs types de traitements en complément.

Dans une tout autre branche, Veolia a réalisé une « boucle courte » pour alimenter la chaudière d’un fabricant de pneumatiques. Les eaux des presses de cuisson, chargées de caoutchouc, huiles et graisses, auparavant éliminées via une filière externe, sont désormais traitées sur site par évapoconcentration, et réutilisées pour la chaudière.
Élisée François, responsable commercial Traitement de l’eau chez Babcock Wanson, spécialiste des chaudières à vapeur, souligne que « les chaufferies industrielles sont fortement consommatrices d’eau et d’énergie.
Notre bureau d’études dédié à la REUT s’appuie sur notre expertise de chaudiériste pour proposer à nos clients des solutions d’optimisation globale. Nous travaillons sur des procédés visant à réduire les purges mais également à réduire la consommation des eaux d’appoint en réutilisant par exemple des eaux de STEP pour alimenter nos chaudières vapeur.»
BWT intervient également pour ce type de réutilisation, par exemple sur le site d'un industriel de l'aéronautique. « À la sortie de la station d'épuration, nous avons installé un filtre à sable plus une désinfection par notre technologie ECO-MX (électrolyse de sel). Les effluents traités sont dirigés vers la TAR du site. Il n'y a pas besoin de déminéraliser étant donné la qualité des eaux en amont. Ce genre de projets, à base de technologies simples, en particulier sans membranes, peut aboutir rapidement », souligne Dimitri Monot, ingénieur technico-commercial chez BWT.
Jérôme Mougel, directeur général d'Odyssée Environnement, distingue lui aussi l'eau utilisée dans le procédé (en tant qu'ingrédient, de solvant ou pour le nettoyage) de l'eau en tant que vecteur de calories (vapeur, eau chaude, TAR). « Les TAR comme les chaudières exigent une eau qui ne soit ni entartrante ni corrosive. Or ce sont deux contraintes antinomiques. En tant que chimistes, nous proposons des additifs de conditionnement permettant de rendre l'eau utilisable. Pour les chaudières, nos additifs sont certifiés NSF et biodégradables à 96 %, un atout pour la réutilisation. Pour les TAR, nos produits sont intégralement biodégradables. Il ne faut pas oublier qu'une partie part en vapeur dans l'atmosphère et une partie en purge vers le milieu récepteur », souligne-t-il.

En Martinique, l'eau des distilleries prend une seconde vie grâce à Nereus. Depuis 2022, la société française opère en effet une installation de recyclage des eaux de distillerie fondée sur des procédés membranaires innovants. En termes de résultats, 75 % de l'eau contenue dans les vinasses est aujourd'hui récupérée, soit un volume de près de 100 000 m³ par an, une ressource précieuse qui couvre 80 % des besoins en eau de la distillerie et qui est réinjectée directement dans le procédé, notamment pour l'imbibition de la canne. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là.

En réduisant drastiquement les besoins en stockage et en traitement externe, l'installation a également permis de libérer plus de 6 000 m² de foncier, désormais disponibles pour de nouveaux développements industriels.
« Cette réalisation est un bel exemple de ce que peut apporter la technologie membranaire quand elle est pensée comme un levier stratégique et non comme une simple solution technique, explique Patrick-Jean Pichavant, directeur commercial de Nereus.
Nous ne nous contentons pas de traiter de l'eau, nous aidons nos clients à gagner en autonomie, à réduire leur empreinte environnementale et à créer de la valeur sur leurs sites. »
Isabelle Gorna, responsable du département Traitement de l'eau chez Babcock Wanson, explique la méthode globale mise en œuvre par ses équipes : « Porter en premier lieu notre attention sur le respect des normes de qualité d'eau d'appoint, dans la chaudière et au rejet, est la première condition pour garantir une consommation d'eau la plus frugale possible dès le départ. En fonction du type de chaudières (tubes de fumées, serpentin, électrique), la qualité d'eau d'appoint sera ajustée en regard du taux de purge pour optimiser encore la consommation.
La mise en place de dégazeurs thermiques nous permet en outre de récupérer et de réutiliser les condensats. Nous avons par exemple mis en œuvre, pour plusieurs industriels, des solutions de réutilisation d'eau en boucle courte, destinées à alimenter le refroidissement des purges au niveau du pot d'éclatement, permettant ainsi à chaque fois l'économie de plusieurs mètres cubes par heure d'eau adoucie. »
AGROALIMENTAIRE : TENIR COMPTE DES NORMES SANITAIRES
L’industrie agroalimentaire consomme beaucoup d’eau pour ses procédés mêmes, ne serait-ce que pour le lavage des matières premières et le nettoyage en place des installations sans compter celle qui entre dans la composition des aliments produits, dite « eau ingrédient ». Puisqu’elle est en contact, direct ou non, avec des aliments, cette eau est soumise aux normes sanitaires strictes régissant les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH).
Longtemps exclus, le recyclage et la réutilisation sont désormais possibles en France, encadrés par un ensemble de textes législatifs. Le décret initial de janvier 2024 « relatif aux eaux réutilisées dans les entreprises du secteur alimentaire » a été complété par un décret rectificatif et un arrêté d’application en juillet de cette même année. En mars 2025, une instruction technique précisait le dispositif. Pour l’instant, la réutilisation de l’eau en tant qu’ingrédient reste toutefois exclue en France.
« Dans l’agroalimentaire, l’eau destinée à des usages “mécaniques” comme le lavage des caisses, des sols ou des camions peut être de qualité moyenne, par exemple ultrafiltrée et désinfectée. Elle peut donc provenir de la REUT. Pour les usages impliquant un contact alimentaire, on utilisera plutôt de l’eau osmosée (et désinfectée) », précise ainsi Mathieu Delaunay, directeur commercial d’Aquaprox I-Tech.

La firme avance de nombreuses références auprès d’abattoirs en Belgique. « Cela peut concerner de très forts débits (jusqu’à 40 m³/h). En sortie de STEU biologique, l’effluent est traité par ultrafiltration et osmose inverse, puis désinfecté. L’eau est alors qualifiée pour le contact alimentaire et réutilisée pour le rinçage des équipements », explique Mathieu Delaunay. La société recycle aussi des eaux de concentration de la matière laitière (ECML). « Pour les réutiliser en TAR, un simple traitement au charbon actif et une désinfection suffisent. Pour le nettoyage en place des installations, il faut passer par une osmose inverse. En pratique, même si les ECML en elles-mêmes sont généralement de bonne qualité, leur concentration en matière organique peut tout de même varier. Nous installons donc des capteurs simples (DCO, turbidité…) en sortie de l’évapoconcentrateur pour diriger l’effluent soit vers la STEU soit vers le recyclage », détaille-t-il.
Il suffit parfois de mobiliser des technologies encore plus simples. Par exemple, comme l’explique Mathieu Delaunay, « pour le nettoyage initial des légumes, il suffit en général d’installer un dessablage et une désinfection sur la boucle de recirculation de l’eau ». Grâce à une large gamme de charbons actifs combinés avec des solutions de filtration mobiles durables, Desotec accompagne les industriels dans leurs projets de réutilisation de l’eau. Généralement, l’utilisation finale de l’eau traitée est la même que sa source d’origine : par exemple, l’eau de traitement est réutilisée dans les procédés industriels, et l’eau des réacteurs de refroidissement est recyclée pour le même usage.
Xylem met notamment en avant l’eau de rinçage de bouteilles de vins, qui tourne en boucle, sans perte, grâce à de l’eau ozonée. L’ozone est très puissant, ne laisse pas non plus de sous-produits chlorés et peut être préparé à la demande sur un chariot complet avec tous les accessoires. Cette procédure évite ainsi les nettoyages avec des produits chimiques puis avec de l’eau il faut alors énormément d’eau pour rincer les produits, ce qui fait autant d’eau économisée. Et le client gagne également du temps car la désinfection à l’ozone est presque instantanée alors que les rinçages chimiques étaient longs.
Un autre exemple est le rinçage de fruits ou de légumes. Les fruits sont disposés dans un bac de lavage, l’eau tourne en boucle et elle est filtrée puis désinfectée aux UV pour éviter les sous-produits chlorés. Parfois, il est possible de récupérer de l’eau qui vient du lait des animaux : la réutilisation de l’« eau de vache » (Condensate of Whey water ou COW water), c’est-à-dire la récupération de l’eau de condensation du lait. Pour un industriel dans l’ouest de la France, le fabricant désinfecte un débit d’eau de 200 m³/h avec du chlore gazeux et cette eau est ensuite réutilisée pour différents procédés.
En complément ou en alternative à des technologies, l’ozone ou les systèmes à UV offrent une désinfection continue, parfaitement adaptée aux circuits fermés et aux opérations de nettoyage en place. Cette approche contribue à réduire l’empreinte environnementale tout en garantissant un haut niveau de performance sanitaire. Par exemple, Bio-UV Group fournit des systèmes de traitement par ozone pour des industries utilisant des procédés d’embouteillage permettant de détruire les bactéries et virus dans le contenant.
Dans les procédés agroalimentaires, si l’eau de trempage ou de rinçage des aliments joue un rôle essentiel dans la qualité et la sécurité des produits finis, elle peut cependant devenir un vecteur de contamination microbienne si elle n’est pas correctement maîtrisée. Le fabricant propose des solutions de désinfection par UV, qui garantissent une eau de trempage saine et stable dans le temps, sans ajout de produits chimiques ni altération des caractéristiques du produit. Ce principe a notamment séduit Galbani, acteur majeur du secteur fromager, pour la désinfection de son eau de trempage utilisée dans la fabrication de sa mozzarella.
BWT intervient également dans l’agroalimentaire. « Nous avons réalisé une installation de REUT, donc en sortie de station d’épuration, pour un industriel de la viande. Les effluents passent sur un filtre à sable et une désinfection par notre réacteur ECO-UV, et sont réutilisés pour le lavage des bétaillères. Dans ce cas-là, il suffit en effet d’éliminer les matières en suspension et la pollution microbiologique, mais il est inutile de déminéraliser », explique ainsi Dimitri Monot. BWT a également réalisé une installation de recyclage de l’eau de lavage des bouteilles pour un industriel de la boisson. L’eau sortant du lavage est simplement traitée par la technologie ECO-UV (rayons UV plus peroxyde d’hydrogène), ce qui assure à la fois sa désinfection et l’oxydation avancée d’éventuels restes de pollution organique. Elle est ensuite réutilisée dans des pompes à anneau liquide, des convoyeurs ou comme liquide de refroidissement.
« Nous travaillons, pour une laiterie, sur un projet de réutilisation de 70 % des effluents de la STEP du site. Dans ce cas de figure, nous utilisons souvent des technologies membranaires. Les effluents traités sont réutilisés dans le procédé, plus précisément pour le nettoyage en place (NEP), à l’exception du dernier rinçage. Ce type d’opérations va se développer, et nous disposons de toutes les technologies nécessaires », affirme, de son côté, Luc Méjean, directeur du développement chez Nijhuis Saur Industrie.
MÊME LA PHARMACIE...
Avec ses strictes exigences de qualité (par ordre croissant, eau purifiée, eau « ultrapure » et eau pour solutés injectables) définies par la pharmacopée, on pourrait imaginer que le secteur de la pharmacie et de la cosmétique n’est
Pas adepte du recyclage, encore moins de la REUT. Et pourtant… « Il est évidemment exclu de produire de l’eau hautement purifiée à partir d’autre chose que de l’eau potable du réseau ou d’une source naturelle de qualité. Le recyclage rencontre donc des limites en pharmacie. Nous sommes cependant sollicités et avons réalisé des installations. Ne serait-ce que parce que la production d’eau de qualité pharmaceutique est le premier poste de consommation des sites, mais aussi de production d’effluents puisqu’ils doivent se débarrasser des rejets des unités d’ultrafiltration, osmoseurs, unités d’ultrafiltration, etc. », souligne Étienne Fiquet (Veolia).
Par exemple, sur un site pharmaceutique utilisant un osmoseur pour faire de l’eau ultrapure à partir de l’eau du réseau, Veolia a mis en place un deuxième osmoseur (dit « concentrateur ») pour traiter… le concentrat du premier. Cette installation fournit une eau envoyée vers la chaudière du site, laquelle produit la vapeur nécessaire à la stérilisation des milieux de culture. Un industriel de la cosmétique a également fait appel à Veolia pour réutiliser les effluents de sa STEP, laquelle reçoit essentiellement des eaux de lavage le principal poste de consommation de ce site.
« Nous traiterons ces effluents avec une installation aux normes hygiéniques en termes de matériaux et de conception et ils seront réutilisés pour comme eau de premier lavage des installations ou de lavage des sols. Nous concevons également la station d’épuration, en prenant en compte le fait que ses effluents seront traités pour réutilisation. De manière générale, nous traitons de plus en plus de dossiers de REUT liés à la remise à niveau d’une station d’épuration », précise Étienne Fiquet.
Aquaprox I-Tech intervient également en cosmétique, sur le site d’un grand acteur de ce domaine. Les effluents de la station d’épuration biologique, à raison de 3 m³/h, sont traités par ultrafiltration et osmose inverse, puis désinfectés et réutilisés dans le procédé pour le nettoyage en place. « Un autre industriel d’une branche proche de la pharmacie rejette, à raison de 40 m³/h, une eau de procédé de bonne qualité générale mais polluée par deux molécules problématiques interdisant à la fois leur rejet dans la nature et leur recyclage. Les tests que nous avons réalisés ont montré qu’un traitement oxydant à l’ozone suffit pour détruire ces molécules. Ces eaux ainsi retraitées seront donc directement renvoyées vers la TAR du site », révèle Matthieu Delaunay (Aquaprox I-Tech). Nijhuis Saur Industrie met aussi en avant une grosse référence en cosmétique. « Le groupe L’Oréal met en place dans le monde entier des solutions de REUT vers le procédé — à l’exception de l’utilisation comme ingrédient », affirme ainsi Luc Méjean.
DES DOMAINES « MOINS EXIGEANTS »
De nombreuses industries, chacune avec des priorités de traitement différentes, ont installé des systèmes de réutilisation de l’eau comprenant des filtres de Desotec. À titre d’exemple, quatre secteurs, qui ont une forte demande en eau, sont particulièrement intéressés par les solutions de traitement et de réutilisation de l’eau : l’industrie du papier un traitement est nécessaire pour réduire les niveaux de DCO, l’industrie des cosmétiques et des parfums dans ce secteur, il est important d’éliminer la DCO tout en empêchant le développement des bactéries, l’industrie chimique les hydrocarbures doivent être éliminés des eaux de rinçage et de traitement avant leur réutilisation et l’industrie du recyclage. Dans ce dernier secteur, les eaux usées provenant des processus de lavage, de rinçage et de refroidissement contiennent souvent des traces de produits alimentaires et de nettoyage ainsi que des impuretés telles que des BTEX, des HAP et des huiles minérales, mesurées en DCO.

KWI a toujours été sensible au sujet de la REUT et fournit des solutions adaptées à chaque besoin, y compris dans des installations mobiles compactes.
« Nous proposons deux grands types de traitement pour la REUT chez nos clients industriels. Le premier consiste en une filtration fine et une désinfection, et il est utilisé pour permettre le lavage de quais dans l’industrie agroalimentaire, par exemple. KWI réalise plusieurs installations de ce type chaque année. »

L’eau produite par une station équipée d’un évapo-concentrateur est stérile, déminéralisée et chaude. Ceci ouvre le champ des possibles pour de la REUT in situ. KMU Loft Cleanwater fournit des solutions complètes depuis plus de 30 ans et réalise 80 % de ces projets dans le cadre d’un « zéro rejet liquide » (Zero Liquid Discharge ou ZLD). Quasiment toutes les industries sont concernées et impliquées actuellement. « Les applications historiques sont dans le traitement de surface et la transformation des matériaux, où la minéralité est un critère clé pour la REUT.
Le lavage de machines et outils de production considère également la réutilisation des eaux usées traitées. L’industrie du packaging-cartonnerie consomme également une quantité importante d’eau pour les chaudières. Cette même industrie produit des effluents encrés et des colles amidonnées. Les stations de REUT traitent ces eaux à destination des eaux de chaudières (usage moins exigeant mais très consommateur). Ceci montre qu’il y a plusieurs usages au sein d’une usine et que la REUT s’intègre parfaitement et réduit in fine considérablement le prélèvement d’eau à la source. Les applications de la REUT plutôt récentes sont dans la cosmétique mais aussi dans la filière viti-vinicole. Dans la plupart des cas, nous travaillons sur la réutilisation comme premier lavage des installations de production. Parfois, il est question de produire une eau pendant un certain temps (6 mois à 1 an, par exemple) avec analyses régulières pour convaincre le site de production et permettre aux services de production de définir des critères propres aux différents usages pour mettre en place la REUT », explique Jean-Lin Laurouaa, directeur Ventes et Études de KMU Loft France.
LES FABRICANTS PROPOSENT DES SOLUTIONS COMPACTES VOIRE MODULAIRES.

« Selon le secteur industriel et l’objectif d’usage final de l’eau usée traitée, la qualité d’eau requise n’est pas nécessairement très haute et un simple traitement physico-chimique (flottation ou décantation plus filtration non membranaire) suffit, éventuellement suivi d’une désinfection afin de prévenir tout risque sanitaire pour les opérateurs qui pourraient entrer en contact avec le fluide.
Il faut cependant garder à l’esprit les contraintes d’installation et d’exploitation de la majorité des industriels : le manque de place, l’agressivité des effluents et le manque de personnels qualifiés pour assurer la performance du traitement. Cette dernière est primordiale puisque qu’une baisse de qualité d’eau pourra nuire à la production et empêchera donc sa réutilisation dans l’usine. C’est pourquoi nous avons conçu des systèmes ultra compacts (dans un container ou sous forme d’un skid), en polypropylène (insensibles à la corrosion) et modulaires pour s’adapter aux évolutions du procédé de production de l’usine. Les services associés de suivi et de maintenance que nous proposons permettent d’assurer la performance du système 100 % du temps, l’industriel pouvant se consacrer pleinement à sa production », explique Olivier Bousige, directeur commercial d’ExoCell.

La tendance actuelle vers des solutions modulaires a favorisé le développement de bioréacteurs à membranes (BRM ; voir EIN n° 484) compacts, un domaine dans lequel Sigmadaf concentre une partie de son innovation. Ses équipements, intégrés dans des conteneurs en acier inoxydable, sont livrés entièrement montés et prêts à fonctionner (Plug & Play), offrant ainsi des avantages majeurs, à savoir la mobilité et la facilité d’installation. De plus, leur mise en œuvre ne nécessite pas de travaux civils complexes, ce qui accélère la mise en service et réduit les coûts d’infrastructure.
L’une des particularités du design Sigmadaf réside dans l’intégration de renforts externes en U (U-shaped) sur les cuves en acier inoxydable. Ces profils agissent comme des « colliers » structurés qui améliorent la résistance à la pression interne de l’eau, notamment sur les parois longues du réservoir, où la pression hydrostatique peut provoquer des déformations ou des bombements. En parallèle, ces renforts contrôlent le flambage des panneaux minces, répartissent plus uniformement les efforts entre les points d’union et confèrent une plus grande rigidité à l’ensemble, et ils ne réduisent pas le volume utile du réservoir et facilitent les opérations d’inspection et de maintenance.
Très logiquement, ce sont les industries non soumises à des normes alimentaires ou médicales qui se sont les premières lancées dans le recyclage ou la réutilisation de leurs eaux. « Nous avons beaucoup de références, depuis longtemps, pour des activités comme le traitement de surface, où l’on s’intéresse à la minéralité des eaux utilisées mais pas à leur qualité sanitaire. Cela ouvre beaucoup plus de possibilités», explique ainsi Matthieu Delaunay (Aquaprox I-Tech). D’où des réalisations de recyclage en aéronautique, automobile, etc.
Par exemple, Aquaprox I-Tech met actuellement en place le recyclage intégral (ZLD) des eaux d'un très important site de production automobile. «À partir des eaux de rinçage, soit 400 m³/j, nous pourrons produire des eaux de différentes qualités : déminéralisées pour les rinçages “courants” et désionisées pour des réutilisations plus sensibles», affirme Matthieu Delaunay.
Autre usage « non noble » : Aquaprox I-Tech est intervenue auprès d'un recycleur d'emballages plastiques. L'eau utilisée pour le nettoyage de ces déchets subit un simple traitement physique avant de repartir en tête. «Lorsque la concentration en pollution organique devient trop importante, nous purgeons la boucle et envoyons les effluents vers un traitement biologique. L'installation “fait tourner” 80 m³/h d'eau et en purge simplement 3 m³/h», précise Matthieu Delaunay.
Autre poste omniprésent de consommation d’eau de qualité « moyenne » : la station d’épuration elle-même. Il faut en effet de l'eau pour nettoyer les dégrilleurs ou les tables d’égouttage, préparer les suspensions de floculants, etc. Et quoi de plus logique, dès lors, que de réutiliser sur place les effluents de cette station, après désinfection et éventuellement filtration ? De nombreux traiteurs d'eau mentionnent ce type de réalisation. Un autre traitement où le charbon actif est une nécessité est la captation et l’élimination des PFAS. De plus en plus d’industriels sont en effet confrontés à la dure réalité de devoir prendre des actions afin de traiter ces polluants éternels. Grâce à des charbons actifs bien spécifiques et à des procédés de réactivation et d’élimination des PFAS, Desotec propose une solution durable, efficace et économique à cette problématique majeure.
« L’effort de réduction de la consommation d’eau peut se faire très tôt dans la chaîne de valorisation du prétraitement, précise Clément Desgardin, responsable Projet Traitement de l’eau chez Babcock Wanson.
Nous avons par exemple restandardisé des technologies d’adoucissement plus économes en eau et en sel. Un industriel de l’automobile a ainsi revalorisé ses purges d’osmoseur aux régénérations des adoucisseurs. Plus le point de rejet se rapproche du point d’usage, plus cela devient une évidence technico-économique. »
Outre les dispositifs de recyclage d’effluents traités vers les TAR ou les chaufferies, Isabelle Gorna, de Babcock Wanson, souligne que « la meilleure économie d’eau est celle qu’on ne consomme pas, et que nos services interviennent sur tout le territoire sur de nombreuses installations existantes d’adoucissement ou de déminéralisation, parfois vieillissantes, pour les transformer dans le double but de réduire à la fois la consommation primaire d’eau et l’utilisation de réactifs chimiques. »
LA SOBRIÉTÉ HYDRIQUE PASSE PAR L’INTÉGRATION DU DIGITAL, DE L’IA…
« La REUT s’appuie sur les mêmes briques technologiques que celles que nous maîtrisons depuis plus de 30 ans : la séparation membranaire, la reminéralisation, la désinfection… Ce qui change, c’est la manière de les orchestrer. Les entreprises riches de milliers d’heures d’exploitation et de données terrain sont aujourd’hui les mieux armées. Grâce à l’intelligence artificielle (IA), ces données deviennent une véritable mine d’or : elles permettent d’anticiper les dérives, d’optimiser les lavages et d’augmenter les rendements sans compromettre la qualité du produit fini. Sur une ligne d’ultrafiltration, par exemple, nous avons observé que 12 % de l’eau partait auparavant en lavage inutile. L’IA a permis d’anticiper les pics de production et d’adapter automatiquement le pilotage et les cycles de nettoyage. Résultat : ces pertes ont été éliminées, l’électricité réduite de 8 % et la durée de vie des membranes prolongée. Les données d’exploitation, autrefois dormantes, deviennent un levier de performance et de durabilité. C’est là que réside la vraie révolution », explique David Cabanes, président-directeur général d’ICE Water Management.
Face à l’intensification du stress hydrique et à la nécessité de préserver la ressource, Schneider Electric s’engage aux côtés des industriels pour transformer la gestion de l’eau en un véritable levier de performance, de conformité et de durabilité. La sobriété hydrique ne se limite plus à l’optimisation des procédés ou à la mise en place de technologies de traitement. Elle passe désormais par l’intégration du digital, de l’automatisation et de l’IA au cœur des installations industrielles. Grâce à ses solutions EcoStruxure et Aveva, Schneider Electric accompagne les industriels à chaque étape : l’instrumentation et la collecte de données grâce à des capteurs « intelligents », l’analyse avancée et le pilotage « intelligent », l’optimisation dynamique des procédés (gestion prédictive des équipements, réduction des effluents et des consommations énergétiques) et l’accompagnement sur mesure (audit, conseil, intégration, formation et support). Le groupe français met en avant des résultats concrets : jusqu’à 30 % de réduction de la consommation d’eau, 35 % de réduction des pertes, 20 % d’économie d’énergie et une meilleure conformité réglementaire. En intégrant la digitalisation à la gestion de l’eau, Schneider Electric permet aux industriels de passer d’une logique de contrainte à une dynamique de création de valeur, au service de la performance économique et environnementale.
« Dans certaines régions du monde, le stress hydrique est une réalité quotidienne. Travailler dans ces environnements nous a obligés à concevoir des systèmes capables de fonctionner avec peu de ressources et un haut niveau d’exigence. Cette contrainte a été une formidable école d’ingénierie : un système robuste doit être simple à exploiter, à maintenir et à réparer. Cette philosophie, née sur le terrain, guide aujourd’hui nos réalisations avec des solutions fiables, durables et accessibles et qui garantissent la continuité de production même dans les contextes les plus contraints. C’est ce retour d’expérience internationale, combiné à la maîtrise des technologies les plus avancées, qui nous permet d’accompagner efficacement les industriels vers une gestion responsable et performante de l’eau. La REUT industrielle ne s’improvise pas : elle se bâtit sur des années de données, d’expérience et d’apprentissage continu », conclut Cyril Tournier, responsable Ingénierie avant-projets chez ICE Water Management.